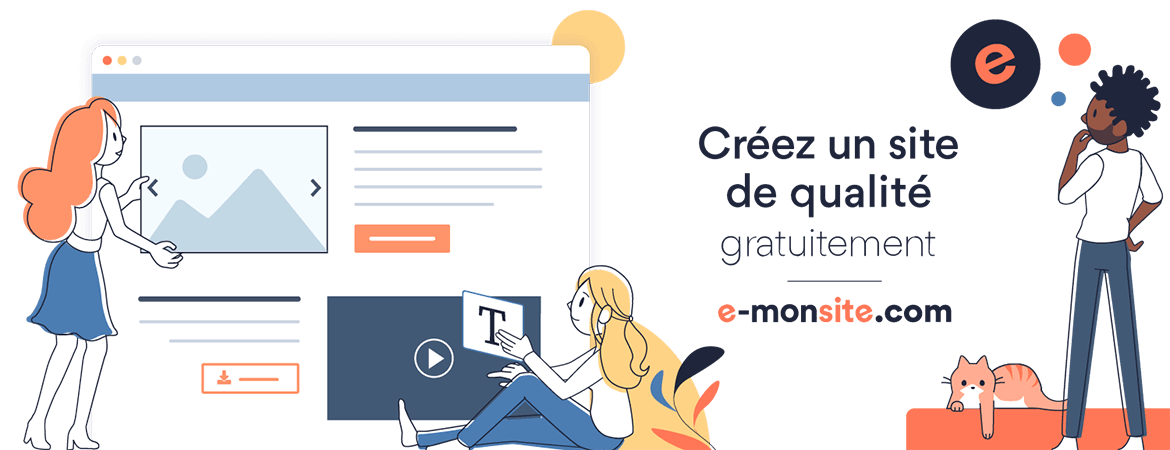BIENVENUE EN ETHNOLOGIE

(source : Gary Larson)
L'ethnologie est certainement une des meilleures façons d'ouvrir l'esprit des élèves. J'ai donc décidé de les initier à cette belle dicipline en EMC (Enseignement Moral et Civique) avec ce très gros dossier. Je les ai fait travailler de la manière suivante : ils ont du lire la première partie consacrée à la présentation de l'ethnologie et répondre au questions posées. Ils ont pu ensuite choisir entre les deux dossiers proposés : le premier sur la diversité des formes familiales, le deuxième sur les mythes (on retrouve là les deux grands thèmes de travail de Claude Lévi-Strauss, thèmes qui ont d'ailleurs constitué la matière première du beau livre de Maurice Godelier sur Lévi-Strauss). On trouvera ce dossier ci dessous ou en téléchargement.
![]() Bienvenue en ethnologie general (272 Ko)
Bienvenue en ethnologie general (272 Ko)
PARTIE I : SOCIETES ET CULTURES.
Document 1 : Les questions abordées par l’ethnologie
La diversité des activités et des comportements humains, la pluralité des sociétés et des cultures ont fasciné les ethnologues, dont la première tâche fut d'élaborer une grille de lecture ordonnée et logique pour organiser leurs descriptions et leurs explications. C'est pourquoi l'ethnologie prend si facilement l'aspect d'un ensemble de thèmes fondés sur des questions théoriques particulières.(…) Chaque champ permet de situer les sociétés étudiées à distance du progrès occidental : la simplicité technologique n'a rien à voir avec la révolution industrielle, les modèles familiaux sont aux antipodes des vertus bourgeoises du xixe s., les systèmes de valeurs comme les logiques mentales semblent confirmer la supériorité intrinsèque de la rationalité cartésienne, enfin le juridique et le politique prouvent que leur création est bien le résultat d'une liberté et d'une individualité uniques. (…)Viennent enfin les spécialisations par aires géographiques et culturelles. À ses débuts, l'ethnologie présentait une vision hétéroclite des exemples traités, bien qu'elle insistât sur le comparatisme d'un trait culturel ou d'une institution : son approche compilatoire et livresque des phénomènes en est certainement la raison. Le passage à l'enquête de terrain de longue durée a obligé les ethnologues à affiner leur méthodologie de collecte et de vérification des données et, par conséquent, à renverser leur perspective en se spécialisant d'abord sur une seule société, puis éventuellement sur un thème. Ce phénomène explique la multiplication des monographies ethnographiques à partir de l'entre-deux-guerres sur une ethnie ou un ensemble culturel relativement circonscrit.
Les technologies culturelles L'inventaire des technologies est une œuvre de longue haleine. L'existence de musées d'ethnologie ou d'arts populaires richement pourvus ne doit pas masquer la complexité ni l'actualité de la recherche dans ce domaine : le patrimoine ethnologique en France permet l'étude des métiers qui disparaissent afin d'aider à la revalorisation de techniques trop vite délaissées. (…) C'est pourquoi la technologie culturelle s'intègre aux modes de production, de consommation, d'échange, de distribution, ou de destruction (les arts de la guerre reposent sur l'ensemble des autres performances techniques). Il s'agit donc d'un domaine particulièrement dynamique, contrairement à l'image statique qu'inspirent les outils et les objets figés dans les vitrines des musées. (…) La tradition française se veut plus analytique et systématique. Si Mauss accorde une place assez importante à la technologie (un tiers de son manuel lui est consacré), il met l'accent sur les techniques du corps. L'étude de l'utilisation du corps, de l'accouchement à la natation, des actes du travail aux mouvements purement ludiques, ouvre un champ véritablement ethnologique à la perception des techniques. (…)
De la structure familiale à l'organisation sociale La parenté et plus généralement l'organisation sociale restent historiquement le cœur de la discipline. C'est encore à L.H. Morgan que l'on doit les fondements de son étude comparative (Systèmes de consanguinité et d'alliance de la famille humaine, 1871).
(…)Religions, représentations et croyances Le deuxième thème fondateur de l'ethnologie est probablement le plus ambigu, puisqu'il porte sur l'essence même de toute société, c'est-à-dire sur l'idée et l'image qu'elle se fait d'elle-même et de l'univers qui l'entoure, de son origine et de son destin. . (…)Les théories sociologiques et ethnologiques des xixe et xxe s. trouvent dans l'idéologie, les représentations collectives ou encore le sacré le moteur de toute organisation sociale digne de ce nom. . . (…) L'ethnologie s'est d'abord spécialisée dans les religions et les croyances propres à chaque culture, à chaque ethnie, à chaque groupe, d'où un impressionnant panorama ethnographique qui a donné lieu à des typologies. Mauss distinguait ainsi le sacré, la magie et la divination, et enfin les superstitions. Depuis les années 1950, une nouvelle démarche s'est progressivement imposée. La religion comme institution sociale cède la place aux systèmes de représentation et d'interprétation du monde naturel et humain. Le sacré, la sorcellerie, la notion de personne, plus abstraitement encore la pensée sauvage (Cl. Lévi-Strauss) ou l'« idéo-logique » (Marc Augé) participent d'une anthropologie du symbolique qui dissout de fait l'ethnologie religieuse, puisque les croyances en des dieux et au surnaturel ne manifestent que l'aspect particulier de propriétés plus générales . . .
L'ordre, le droit et la politique Dès ses origines, la réflexion ethnologique a posé la question de l'ordre social, c'est-à-dire du règlement des disputes et des conflits. L'ethnocentrisme juridique des sociétés occidentales du xixe s. a conduit à s'interroger sur les conditions de création du droit dans des sociétés qui ignoraient, semble-t-il, la distinction entre les domaines public et privéCe sont les problèmes mêmes du contrôle social, de la logique politique, qui assurent la cohésion des groupes et des hiérarchies, qui imposent une lecture juridique des phénomènes sociaux. La vie la plus quotidienne (les droits et devoirs du champ de la parenté), les inégalités naturelles et leurs contradictions (comment faire respecter les prérogatives de tous ou de certains membres du groupe), les rituels religieux et les enjeux du pouvoir (comment obtenir et faire respecter l'adhésion et l'obéissance à des règles) sont autant de domaines où s'élaborent la perpétuation des sociétés, des cultures et, par conséquent, les réglementations (prescriptions, médiations, interdictions), le droit en tant qu'habitude, tradition et mémoire. (…) L'ethnologie juridique cède alors la place à une anthropologie politique : le pouvoir, l'État, la loi et l'ordre, la stabilité et le changement (y compris celui que provoque l'acculturation juridique née de l'introduction coloniale de législations occidentales) deviennent les objectifs d'une recherche plus globale. (…)
L'économie La préoccupation la plus tardivement manifestée porte sur le champ de l'économie. (…) Ce sont d'abord des phénomènes d'échange, de consommation rituelle ou sociale qui sollicitent les ethnologues, car ils semblent relever d'une mentalité pré- ou antiéconomique. Les ethnologues cherchent aussi à expliquer les conditions de production des biens et des objets qu'ils recueillent. L'organisation sociale, la division sexuelle du travail, les conceptions de l'accumulation et de la redistribution (le rôle de la monnaie, par exemple) (…). D'où des méthodes spécifiques de relevé des informations et la mise au point de techniques proprement linguistiques pour comprendre et transcrire tant de langues non écrites. (…) Le domaine préféré des ethnologues est cependant celui des conceptions du monde, des modes de réflexion et de pensée, de l'interprétation des réalités naturelles et humaines, de ce que d'aucuns appellent les « mentalités ». Le domaine des savoirs portant sur l'univers matériel et immatériel des sociétés étudiées par les ethnologues est immense, et il est normal que le découpage des sciences occidentales de la nature ne corresponde que fort peu à leurs manières de classer et d'expliquer. (…) (http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/ethnologie/49734 )
Document 2 : Les cultures peuvent-elles être hiérarchisées?
La culture des différents peuples reflète, essentiellement, leur passé historique et varie dans les limites mêmes où leurs expériences ont été différentes. De même que pour l'individu, c'est l'acquis beaucoup plus que l'inné qui compte pour les peuples ; de la diversité des expériences résultant des acquis divers, le monde est maintenant peuplé de groupes humains culturellement fort différents et pour chacun desquels certaines préoccupations dominantes peuvent être regardées comme représentant (suivant l'expression de M. J. Herskovits) le point focal de sa culture. Ce à quoi une société s'intéresse et qu'elle regarde comme important peut différer totalement de ce qu'une autre société fait passer au premier plan : les Hindous ont donné un grand développement aux techniques de maîtrise de soi et de méditation mais n'ont porté jusqu'à une époque récente qu'un très faible intérêt à ces techniques matérielles vers le perfectionnement desquelles nos contemporains américains et européens font tendre leur effort alors qu'ils ne sont guère enclins, dans l'ensemble, à la spéculation métaphysique et, moins encore, à l'exercice de la philosophie ; au Tibet, la vie monacale a toujours pris le pas sur la vie militaire, dont l'importance pour nous est devenue si tragique ; si l'élevage est à tel point valorisé chez maints nègres kamitisés de l'Afrique orientale que le bétail est pour eux un trésor plus qu'un moyen de subsistance et qu'on voit, par exemple, le peuple banioro divisé en deux classes dont la plus haute pratique l'élevage et la plus basse l'agriculture, maints groupes de cultivateurs noirs de l'Afrique occidentale font garder leurs troupeaux par des Peuls qu'ils méprisent. L'existence de pareilles spécialisations culturelles doit inciter à la prudence quand il s'agit de porter un jugement de valeur sur une civilisation ; il n'en est pas une seule qu'on ne puisse trouver déficiente à certains égards alors que sur d'autres points elle a atteint un haut degré de développement ou, à l'examen, se révèle plus complexe que ne le laissait supposer l'apparente simplicité de l'ensemble ; les Indiens précolombiens, qui ne faisaient usage d'aucun animal de trait et ne connaissaient ni la roue ni le fer, n'en ont pas moins laissé des monuments grandioses qui témoignent d'une organisation sociale très avancée et comptent parmi les plus beaux que les hommes aient construits ; parmi ces précolombiens figuraient les Mayas, qui ont inventé le zéro indépendamment des Arabes ; les Chinois — dont nul ne contestera qu'ils ont élaboré une grande civilisation — sont demeurés longtemps sans employer pour l'agriculture le fumier de leurs animaux, ni leur lait pour l'alimentation ; les Polynésiens, techniquement à l'âge de la pierre polie, ont conçu une mythologie très riche ; aux nègres, qu'on croyait bons tout au plus à fournir en main-d'oeuvre servile les plantations du Nouveau Monde, nous sommes redevables d'un apport considérable dans le domaine artistique, et c'est, d'autre part, en Afrique que le gros mil et le petit mil, céréales qui depuis se sont répandues en Asie, ont été pour la première fois cultivées ; les Australiens eux-mêmes, dont les techniques sont des plus rudimentaires, appliquent des règles de mariage répondant à un système de parenté d'une subtilité extrême ; si évoluée soit-elle du point de vue technique notre propre civilisation, en revanche, est déficiente sur bien des points comme le montre — sans même parler des problèmes sociaux que les pays occidentaux n'ont pas encore résolus ni des guerres dans lesquelles ils s'engagent périodiquement — un fait tel que le nombre élevé d'inadaptés qui se rencontrent en Occident. En vérité, on peut dire de presque toutes les cultures qu'elles ont respectivement leurs échecs et leurs réussites, leurs défauts et leurs vertus. La langue elle-même, instrument et condition de la pensée, ne peut servir à établir une hiérarchie entre elles : on trouve, par exemple, des formes grammaticales très riches dans les parlers de peuples sans écriture et regardés comme « non civilisés». Il serait vain également de juger d'une culture en prenant pour critère nos propres impératifs moraux car — outre que notre morale n'est trop souvent que théorique — bien des sociétés exotiques se montrent à certains égards plus humaines que les nôtres : le grand africaniste Maurice Delafosse fait observer, par exemple, que « dans les sociétés négro-africaines, il n'y a ni veuves ni orphelins, les unes et les autres étant nécessairement à la charge soit de leur famille soit de l'héritier du mari » ; d'autre part, il est des civilisations en Sibérie et ailleurs où celui dont nous nous écarterions comme d'un anormal est regardé comme inspiré par les dieux et, de ce fait, trouve sa place dans la vie sociale. Les hommes qui diffèrent de nous par la culture ne sont ni plus ni moins moraux que nous ; chaque société possède son idéal moral selon lequel elle distingue ses bons et ses méchants et l'on ne peut, assurément, juger de la moralité d'une culture (ou d'une race) d'après le comportement, parfois blâmable à notre point de vue, de tels de ses représentants dans les conditions très spéciales que crée pour eux le fait d'être assujettis au régime colonial ou brusquement transplantés dans un autre pays comme travailleurs (qui mèneront, dans la majorité des cas, une existence misérable) ou bien à titre militaire. On ne saurait, enfin, retenir l'argument de tels anthropologues qui taxent certains peuples d'infériorité sous prétexte qu'ils n'ont pas produit de « grands hommes » : outre qu'il faudrait s'entendre, au préalable, sur ce qu'est un « grand homme » (un conquérant dont les victimes sont innombrables ? un grand savant, artiste, philosophe ou poète ? un fondateur de religion ? un grand saint ?), il est bien évident que, le propre d'un « grand homme » étant de se voir reconnu tôt ou tard par un large milieu social, il est impossible par définition qu'une société isolée ait produit ce que nous appelons un « grand homme ». Mais il faut souligner que même dans les régions demeurées longtemps isolées — en Afrique et en Polynésie, par exemple — de fortes personnalités se sont révélées : l'empereur mandingue Gongo Moussa (qui, au mye siècle, aurait introduit le type d'architecture qui est resté celui des mosquées et des maisons riches du Soudan occidental), le conquérant zoulou Tchaka (dont la vie a fourni, vers la fin du siècle dernier, à l'écrivain southo Thomas Mofolo la matière d'une admirable épopée rédigée dans sa langue maternelle), le prophète libérien Harris (qui prêcha en Côte-d'Ivoire en 1913-1914 un christianisme syncrétique), le roi de Thonga Finau, celui de Honolulu Kamehameha (contemporain de Cook) et bien d'autres encore ne doivent peut-être qu'à leur milieu culturel trop fermé et Démographiquement trop étroit de ne pas avoir été reconnus— question de quantité et non de qualité -— par une masse suffisante pour être de « grands hommes » d’envergure comparable à celle de nos Alexandre, de nos Plutarque, de nos Luther ou de nos Roi-Soleil. On ne peut nier, en outre, que même des techniques très humbles impliquent une grande somme de savoir et d'habileté et que l'élaboration d'une culture tant soit peu adaptée à son milieu, si rudimentaire soit-elle, ne serait pas concevable s'il ne s'était jamais produit dans la collectivité envisagée que des intelligences médiocres. Nos idées sur la culture étant elles-mêmes partie intégrante d'une culture (celle de la société à laquelle nous appartenons), il nous est impossible de prendre la position d'observateurs extérieurs qui, seule, pourrait permettre d'établir une hiérarchie valable entre les diverses cultures : les jugements en cette matière sont nécessairement relatifs, affaire de point de vue, et tel Africain, Indien ou Océanien serait tout aussi fondé à juger l’ignorance de la plupart d'entre nous en fait de généalogie que nous sa méconnaissance des lois de l'électricité ou du principe d'Archimède. Ce que, toutefois, il est permis d'affirmer comme un fait positif, c'est qu'il est des civilisations qui, à un moment donné de l'histoire, se trouvent douées de moyens techniques assez perfectionnés pour que le rapport des forces joue en leur faveur et qu'elles tendent à supplanter les autres civilisations, moins équipées techniquement, avec lesquelles elles entrent en contact ; c'est le cas aujourd'hui pour la civilisation occidentale, dont on voit — quelles que soient les difficultés politiques et les antagonismes des nations qui la représentent — l'expansion s'exercer à une échelle mondiale, ne serait-ce que sous la forme de la diffusion des produits de son industrie. Cette capacité d'expansion à base techno-scientifique apparaît finalement comme le critère décisif permettant d'attribuer à chaque civilisation plus ou moins de « grandeur » ; mais il est entendu que ce mot ne doit être pris qu'en un sens, si l'on peut dire, volumétrique et que c'est, d'ailleurs, d'un point de vue strictement pragmatique (c'est-à-dire en fonction de l'efficacité de ses recettes) qu'on peut apprécier la valeur d'une science, la regarder comme vivante ou morte et la distinguer d'une magie : si la méthode expérimentale — dans l'emploi de laquelle excellent les Occidentaux et occidentalisés d'aujourd'hui — représente un progrès indiscutable sur les méthodes aprioristes et empiristes c'est, essentiellement, dans la mesure où ses résultats (à l'inverse de ce qui en est pour ces autres méthodes) peuvent être le point de départ de nouveaux développements susceptibles, à leur tour, d'applications pratiques. Il est entendu, en outre, que, les sciences dans leur ensemble étant le produit d'innombrables démarches et processus divers auxquels toutes les races ont contribué depuis des millénaires, elles ne peuvent en aucune manière être regardées par les hommes à peau blanche comme leur apanage exclusif et le signe, en eux, d'une aptitude qui leur serait congénitale. Ces réserves expressément formulées, on peut souligner l'importance capitale que la technologie (soit les moyens d'agir sur l'environnement naturel) a non seulement pour la vie même des sociétés, mais pour leur développement. Les grandes étapes de l'histoire de l'humanité sont marquées par des progrès techniques qui ont eu de profondes répercussions sur tous les autres domaines culturels : fabrication d'outils et usage du feu, à l'aube des temps préhistoriques et avant même l'Homo sapiens ; production de nourriture grâce à la domestication des plantes et des animaux, ce qui a permis des peuplements plus denses et a amené des groupes humains à s'établir en villages (qui représentaient une transformation notable de l'environnement naturel) et, la spécialisation des tâches croissant, à développer des artisanats, tout cela impliquant un élargissement économique qui donnait une marge suffisante pour des développements considérables dans d'autres branches ; production de la force, qui marque le début de l'époque moderne. Si les premières civilisations de quelque envergure, fondées sur l'agriculture, ont été confinées aux zones que fertilisaient de grands fleuves (Nil, Euphrate et Tigre, Indus, Gange, fleuve Bleu et fleuve Jaune), des civilisations commerçantes se sont ensuite appuyées sur des mers intérieures ou des mers aux terres nombreuses (Phéniciens, Grecs et Romains avec la Méditerranée, Malais avec les mers de l'Insulinde), puis des civilisations fondées sur la grande industrie ont trouvé leurs centres vitaux dans les gisements de charbon de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Asie en même temps que l'aire des échanges devenait planétaire ; nul ne sait, depuis que nous sommes entrés dans l'âge atomique, en quels points de la terre seront situés bientôt -- sauf conflagration destructrice — les principaux foyers de production ni si les grandes civilisations futures ne prendront pas pour cadre des régions qui nous apparaissent aujourd'hui comme déshéritées et où vivent des hommes dont le seul tort est d'appartenir à des cultures moins armées que la nôtre, ayant moins de possibilités d'action sur le milieu naturel mais, en revanche, jouissant peut-être d'un meilleur équilibre au point de vue des relations sociales. (Michel Leiris « Race et civilisation » (extraits) dans « Cinq leçons d’ethnologie »)
PARTIE II : LA FAMILLE
Document n°3 : Les mille et une formes de la famille
« La famille apparaît implicitement à chacun comme un fait naturel et, par extension, comme une fait universel. La croyance populaire en l'universalité, naturellement fondée, de la famille ne concerne pas une entité abstraite susceptible de prendre des formes variables, mais de façon très précise le mode d'organisation qui nous est familier et dont les traits les plus marquants sont la famille conjugale, la reconnaissance de la filiation et la transmission du nom par les hommes, la monogamies, la résidence virilocale ("Tu quitteras ton père et ta mère" dit la Bible ; " La femme doit suivre son mari " dit le code). Si l'on sait désormais qu'il existe ailleurs des usages différents des nôtres, ils sont considérés comme des traits de sauvagerie, des vestiges archaïques, à tout le moins comme des aberrations. Ils sont pourtant pratiqués par des millions d'hommes et de femmes. Si la famille, entendue au premier chef comme " l'union plus ou moins durable et socialement approuvée d'un homme, d'une femme et de leurs enfants " (Lévi-Strauss) semble être, de fait, un phénomène pratiquement universel (avec des variantes cependant), il existe des exemples de sociétés hautement élaborées où ces associations quasi-permanentes n'existent pas. Ainsi le cas fameux des Nayar de la côte de Malabar (Inde) : le genre de vie guerrier des hommes leur interdisait autrefois de fonder une famille. Les femmes, mariées nominalement, prenaient les amants qu'elles voulaient, les enfants appartenaient à la lignée maternelle, l'autorité et les gestion des terres étant aux mains non d'un pater familias, d'un mari, mais des hommes de la lignée, frères des femmes, eux-mêmes amants occasionnels des femmes des autres lignées. Cependant, ce type de groupement, non conjugal, est en lui-même une famille que nous appellerons matricentrée. Si l'union conjugale stable n'existe pas partout, elle ne peut donc pas être considérée comme un exigence naturelle. Mais, à dire vrai, en dehors du rapport physique qui unit la mère à ses enfants (gestation, mise au monde et allaitement), rien n'est naturel, nécessaire, biologiquement fondé dans l'institution familiale lorsqu'on y regarde de près. Même le lien biologique mère-enfant n'a pas partout la même prégnance. Chez les indiens du Brésil, où un homme peut épouser des soeurs ou une mère et des filles qu'elle a eues d'un autre homme, les enfants sont élevés par l'ensemble des co-épouses sans que chacune cherche à se préoccuper plus particulièrement des siens ; chez les Mossi de Haute-Volta, dans de grandes familles polygames, on établit, après le sevrage, une répartition des enfants entres les différentes co-épouses : même celles qui sont stériles ou qui ont perdu leurs enfants ont à élever des enfants qui ne sont les leurs, mais qu'elles chérissent comme leurs et qui, parvenus à l'âge adulte, ne se connaissent d'autre mère que celle qui les a élevés. Le "voix du sang", pour cette fois, ne crie pas très fort ! Sans dresser ici l'inventaire de toutes les formes familiales existantes, mais pour illustrer le caractère de l'institution, on citera, dans la multiplicité des réponses apportées aux désirs fondamentaux (désir sexuel, désir de reproduction) et aux nécessités (nécessité, notamment, d'entretenir et d'élever les enfants), certaines de celles qui nous semblent aller le plus radicalement contre l'évidence du bon sens, la chose au monde que nous croyons, comme la famille, universellement partagée. Ainsi, il va de soi, pour nous, que les partenaires de l'union conjugale sont de sexes différents, que cette union ne se noue qu'entre vivants, que le géniteur des enfants est normalement le père, que la famille conjugale (père, mère, enfants) est l'unité résidentielle et économique élémentaire par laquelle passent l'éducation et l'héritage. Or l'expérience ethnologique montre qu'aucun de ces principes n'est universellement admis.
Mariage légal entre femmes Dans certains populations africaines, il existe un mariage légal entre femmes. C'est le cas chez les Nuer soudanais, patrilinéaires (la reconnaissance de la filiation passe exclusivement par les hommes) où la fille n'est même pas considérée comme appartenant au groupe de son père, sauf si elle est stérile ; dans ce cas elle compte comme un homme. Le mariage légal est sanctionné par le paiement d'une dot en bétail ou " prix de la fiancée " (1), versée par le mari aux parents paternels de son épouse. La femme stérile perçoit aussi, comme " oncle " paternel, des parts des dots versées pour ses nièces, filles de frères. Avec ce capital, elle peut à son tour acquitter le " prix de la fiancée " pour une jeune fille qu'elle épouse légalement et pour laquelle elle accomplit les rites officiels du mariage. Elle lui choisit un homme, un étranger pauvre, pour cohabiter avec elle et engendrer des enfants. Ces enfants sont les siens et l'appellent " père " et elle leur transmet son nom. Son épouse l'appelle " mon mari ", lui doit respect et obéissance, la sert comme elle servirait un véritable mari. Elle-même administre son foyer et son bétail comme un homme le ferait. Au mariage de ses filles, elle reçoit à titre de " père " le bétail de leur dot et remet, pour chacune, au géniteur la vache, " prix de l'engendrement ". Le géniteur ne joue aucun rôle autre que celui pour lequel il a été requis et ne tire de ce rôle aucune des satisfactions matérielles, morales et affectives qui lui sont, ailleurs, liées. Dans ce cas, bien sûr, la femme-époux n'est qu'un ersatz d'homme et ce mariage légal reste tout à fait dans les canons de l'idéologie masculine. Chez les Yorubas du Nigeria, c'est une femme riche et non stérile qui peut légitimement épouser d'autres femmes et en avoir de la même façon substitutive, des descendants bien à elle. Un point annexe : il est exclu de voir dans ces unions, qui ont pour but la constitution d'une famille normale, une forme particulière d'homosexualité féminine.
Le mariage fantôme Aussi fréquent que le mariage entre vifs, le mariage-fantôme légal, toujours chez les Nuer, qui ne peut concerner qu'un mort sans descendance. Ainsi se crée une famille dont les protagonistes sont le mort, qui est le mari légal, la femme épousée au nom du mort par un de ses parents, le mari substitutif lui-même et les enfants qui naissent de leur union. Ces enfants sont socialement et légalement ceux du mort, du seul fait que le partenaire sexuel de la femme a prélevé sur le bétail du défunt le montant de la dot qu'il verse en son nom. Un homme peut épouser des femmes au nom d'un oncle paternel, d'un frère ou même d'une sœur stérile. La veuve d'un homme mort sans descendance, si elle ne peut elle-même concevoir pour lui des œuvres d'un beau-frère, peut aussi épouser une femme au nom de son mari (le père des enfants étant cette fois-ci son mari mort et non plus elle-même). Les enfants connaissent leur statut d'enfants d'un mort et retracent leur généalogie en partant de ce lien. Leur géniteur est pour eux, selon les cas, un oncle paternel ou un frère. La généalogie familiale n'a rien à voir avec l'engendrement biologique et cela d'autant plus que le mari substitutif, s'il n'a pas eu les moyens de doter une épouse pour son compte, mourra à son tour sans progéniture propre : elle lui sera constituée éventuellement par les soins d'un frère cadet ou d'un neveu. Mariage avec un mort, donc, et famille-fantôme, mais qui nous montrent que ni le sexe, ni l'identité des partenaires, ni la paternité physiologique, n'ont d'importance à eux seuls. Comme dans l'adage romain (is est pater quem nuptiae demonstant), ce qui compte, c'est la légalité du mariage, démontrée par le paiement du " prix de la fiancée ".
Mariage polyandrique. Le déni de l'importance de la paternité physiologique se trouve également, chez les Tibétains qui pratiquent le mariage polyandrique : lorsque l'aîné de plusieurs frères a pris légalement une femme, celle-ci épouse successivement chacun des frères de son mari à des intervalles réguliers d'une année. Les homme pratiquant le commerce au long cours s'arrangent de telle sorte qu'il n'y ait jamais plus d'un mari au foyer en même temps. Les enfants sont attribués à l'aîné ; ils l'appellent " père " et appellent " oncle " les autres paris de leur mère. Les frères coépoux sont considérés comme formant une seule et même chair ; ainsi ce type de famille peut-il être tenu pour une simple variante de la famille monogame ; les contractants ne se soucient pas de la réalité de leur paternité individuelle, au profit de leur paternité commune. Point important : la propriété familiale, gérée par l'épouse collective qui règne en maîtresse sur son foyer, est toujours transmise collectivement.
Passons à des situations apparemment moins étranges. Dans les sociétés matrilinéaires, la filiation est comptée et reconnue par les femmes exclusivement. Hommes et femmes du groupe matrilinéaire ont des conjoints, mais le principe de résidence peut varier selon les sociétés : tantôt les hommes se déplacent pour aller vivre auprès de leurs épouses, tantôt les femmes se déplacent pour aller vivre auprès de leurs maris. Dans tous les cas, l'autorité première, la transmission de l'héritage ne s'exercent pas du père au fils, mais de l'oncle maternel au fils de la soeur,. Chaque lignage matrilinéaire (l'ensemble des individus qui descendent par les femmes d'un même ancêtre) possède des biens qui ne peuvent en effet, être transmis à l'extérieur du groupe, ce qui serait le cas si le mère transmettait à son fils, qui appartient selon la règle de filiation au matrilignage de sa mère, les biens qu'il tient de son propre matrilignage. Chez les Senufo de Côte-d'Ivoire, matrilinéaire et polygames, chacun des conjoints reste dans sa famille d'origine, qui est alors la véritable unité domestique de production. Le soir venu, les maris partent rejoindre à tour de rôle (une par jour) leurs différentes épouses qui cuisinent pour eux et leur rendent les services ordinaires du mariage, mais ils ne résident jamais de façon permanent avec une d'entre elles et les enfants qu'ils en ont eus. L'institution est connue sous le nom de " visisting husband ", le mari visiteur. C'est une forme de famille différente de celle pratiquée par les Nayar en ce que, chez les Senufo, le mari est aussi le père de ses enfants. Si la famille est bien un donné universel, en ce sens qu'il n'existe aucune société dépourvue d'une institution remplissant partout les mêmes fonctions (unité économique, lieu privilégié de l'exercice de la sexualité, reproduction biologique, "élevage" et socialisation des enfants) et obéissant partout aux mêmes lois (existence d'un statut matrimonial légal, prohibition de l'inceste, division du travail selon les sexes), et même si le mode conjugal monogame est le plus répandu, l'extrême variabilité des règles concourant à son établissement, à sa composition et à sa survie démontre qu'elle n'est pas sous ses modalités particulières un fait de nature, mais au contraire un phénomène hautement artificiel, construit, un phénomène culturel. »
(1) La dot à la française est perçue comme une incongruité majeure par toutes les autres cultures : non seulement le père se prive de la force de travail et de la capacité de reproduction de ses filles, au bénéfice exclusif d'autres hommes, mais il faut de plus qu'il paye pour cela !
Françoise Héritier
Document n° 4 : La loi du désir comme principe communautaire
Des confins himalayens nous vient une découverte qui bouscule les certitudes du profane comme les théories les mieux établies de l'anthropologie : une société peut exister et se perpétuer sans pères ni maris. Autrement dit, l'alliance et la double filiation instaurant la famille ne sont pas l'alpha et l'oméga de toute communauté humaine. En effet, chez les Na, étudiés par Cai Hua, l'amour libre n'est pas une dissidence, une audacieuse ou une coupable licence, mais une solide institution, et il n'y a, selon notre terminologie évidemment, que des enfants naturels.Cette population de quelque 30 000 personnes vit dans une région reculée de Chine, la cuvette du Yongning, située à 2760 mètres d'altitude, au coeur de massifs culminant à 4 500 mètres, à la lisière des provinces du Yunnan et du Sichuan. Aujourd'hui, deux pistes la relient au reste du pays, la poste fonctionne à peine, les lignes téléphoniques sont rares et les communications quasi inaudibles. Dans le passé, seuls quelques caravaniers arrivaient jusque-là. Pourtant, la réputation des moeurs étranges des Na a depuis fort longtemps traversé les montagnes. De très anciens textes de chroniqueurs chinois les rapportent. Li Jing, par exemple, un auteur de la dynastie des Yuan (1279-1368), s'émeut de l'indécente conduite des femmes. Marco Polo, son contemporain, colporte la nouvelle au-delà des continents : dans son Devisement du monde, le livre des merveilles, il brocarde ces « jobards » qui « ne se soucient en rien si l'un d'eux touche la femme d'un autre, pourvu que ce soit volonté de la femme », et qui vont jusqu'à accepter avec empressement que tous les membres féminins de la maisonnée s'offrent aux étrangers. Une aubaine peut-être pour ces derniers: un précis anonyme du début du XXe siècle, évoquant l'humeur joyeuse des habitants, raconte que, « parmi les commerçants venus de loin, passant dans la région, une grande partie s'y attache et y épuise toute sa fortune ». Après le vagabondage des récits, le pesant bagage de l'idéologie: dans les années 60, des ethnologues chinois défendent, sous les auspices d'Engels, une conception évolutionniste selon laquelle ces populations, restées au stade attardé du mariage par groupe, vont accéder au stade ultime et souhaitable de la conjugalité. Leurs publications ont eu de si fâcheuses conséquences pour les Na que Cai Hua, par la suite, a eu du mal à vaincre leurs réticences et à se faire accepter pour étudier enfin, sans préjugés, leur société. Chercheur à l'Académie des sciences sociales du Yunnan puis au Laboratoire d'anthropologie sociale à Paris, il a fait de longs séjours à Yongning avant de rédiger cette monographie exceptionnelle. Pour les Na, de même que la pluie permet à l'herbe de pousser, l'homme est un « arroseur » qui permet à la femme d'enfanter. Son rôle est nécessaire et bénéfique, mais néanmoins secondaire, car l'os, considéré comme le vecteur des caractères héréditaires, vient de la mère. Tous ceux qui ont un même ancêtre féminin sont dits gens du même os, ils habitent ensemble, partageant « le même pot et le même feu ». Quand un enfant naît, il appartient automatiquement au groupe de celle qui l'a mis au monde. Système de parenté, mode de résidence et unité économique sont ainsi strictement matrilinéaires: dans chaque maisonnée cohabitent la mère, ses enfants des deux sexes, les enfants de ses filles et ainsi de suite, au fil des générations. Les hommes de la maison sont donc toujours des frères ou des oncles maternels. Ces derniers occupent la fonction du père, qui, lui, n'existe même pas dans le vocabulaire. Seuls ceux qui ont un os commun, considérés comme consanguins en somme, sont apparentés et, par conséquent, concernés par la prohibition de l'inceste, qui existe ici comme partout ailleurs. Et de façon très rigoureuse, puisque toute évocation sexuelle, tout propos leste et même tout rapprochement (cheminer ensemble de nuit ou se côtoyer devant la télévision, par exemple) est interdit entre eux. Cette rigueur contraste avec la très grande liberté sexuelle en dehors de la lignée. La « visite furtive» est ce que les Na pratiquent le plus volontiers. Elle a toujours lieu au domicile de l'élue, que son galant vient rejoindre en catimini, autour de minuit, pour la quitter à l'aube. Hommes et femmes, indifféremment, font le premier pas, et chacun peut accepter ou décliner la proposition à son gré. La seule règle est que les consanguins ne soient jamais témoins de ces avances. Même s'ils n'ignorent évidemment pas ces relations si courantes qu'un voleur surpris dans une maison peut s'en sortir en prétendant être un visiteur amoureux, il convient qu'ils ne voient et n'entendent rien. Les rencontres sont souvent éphémères. Les jeunes, surtout, aiment les multiplier; des garçons et des filles réputés pour leur ardeur, leur charme ou leur beauté ont eu ainsi plus d'une centaine d'amants. Il y a cependant des cas où la « visite furtive », devenue assidue, se transforme en « visite ostensible », après échange de cadeaux et réception de l'impétrant par le chef féminin de la maisonnée, hors la présence des hommes. Mais il n'est pas pour autant admis comme résidant, cela n'empêche pas la poursuite d'autres relations même si généralement l'homme et la femme s'accordent tacitement l'exclusivité, et chacun peut rompre quand il le veut. Il y a aussi, beaucoup plus rarement, des cas où la cohabitation d'un couple s'impose : lorsqu'une maisonnée manque de main-d'oeuvre masculine ou que, dans la dernière génération, il n'y a pas de femmes susceptibles de procréer. Là encore, les partenaires se choisissent librement et peuvent se séparer. Toutefois, leur cohabitation doit recevoir l'assentiment des deux lignées. Que l'homme aille chez la femme ou l'inverse, les enfants sont toujours ceux de la mère. Finalement, il n'y a que dans la famille aristocratique du « gouverneur » (le zhifu), où le fils aîné hérite de la charge, que l'on trouve des successions de mariages. Mais ceci est une importation de la dynastie des Qing (1644-1911), une affaire de politique plus que de parenté. Pour preuve : la famille du zhifu ayant perdu son pouvoir en 1956, le fils aîné du dernier zhifu, revenu à Yongning quelques années après, s'est installé chez sa soeur et a opté pour la « visite furtive ». Les coutumes des Na ont ainsi traversé les siècles, le contrôle lointain des empereurs étant plus administratif que moral. Tel n'est pas, en revanche, celui du pouvoir communiste, qui juge la vie des Na primitive (elle « empêche la prise de conscience de la lutte des classes chez le peuple »), contre-productive (ils ne pensent qu'à ça, au lieu de travailler) et malsaine (elle favorise la propagation des maladies vénériennes). Quatre « réformes matrimoniales » vont donc se succéder. La première se veut éducative : des discussions sont organisées avec les villageois pour les convaincre de « la supériorité de la monogamie socialiste ». En 1966, au début de la révolution culturelle, une équipe de travail tente d'imposer le mariage à tous ceux qui pratiquent la « visite ostensible »; c'est un échec, la majorité des couples se séparent après son départ. Et la même démarche, en 1971, aboutit au même résultat. Aussi, en 1974, des mesures très coercitives sont-elles prises: les femmes sont obligées de désigner le géniteur réel ou supposé de leur(s) enfant(s); à défaut, le chef de brigade s'en charge, et le couple ainsi identifié doit s'officialiser afin de recevoir sa ration annuelle de céréales. C'est un « séisme social » : les jeunes n'osent plus se rencontrer tant ils ont peur de se retrouver mariés. Et cela marche très mal: en dépit des pressions, les couples se défont. On n'impose pas un changement de moeurs. Cela change pourtant au Yongning. Car l'école se révèle autrement plus efficace que les réformes. Le na étant une langue sans écriture, c'est en chinois que se fait l'enseignement, d'autant mieux qu'il est délivré par des Na sinisés. Leurs élèves apprennent les valeurs d'ailleurs: dans leurs manuels d'école primaire, il y a toujours un père et « pas de case pour l'oncle maternel ». Ils découvrent aussi, avec la biologie, que l'hérédité n'est pas dans l'os de la mère. Aussi peut-on penser qu'en dépit de sa ténacité la « société de célibataires » des Na va finir par se défaire. Dès lors, elle ne restera plus que dans les annales de l'anthropologie, comme un cas invitant à réviser la théorie. « Le cas na témoigne du fait que le mariage et la famille ne peuvent être considérés comme universels, ni logiquement, ni historiquement ».Il faut revoir la copie. Celle de Radcliffe-Brown, selon laquelle le noyau dur, l'unité de structure de tout système de parenté est la « famille élémentaire », caractérisée par la relation parents-enfants. Celle de Lévi-Strauss, pour qui l'alliance et l'échange institutionnalisé des femmes, garantissant la prohibition de l'inceste et la division sexuelle du travail, sont au principe de toute organisation sociale. Dès lors, qu'est-ce qui est universel, outre la prohibition de l'inceste, qui se passe fort bien, chez les Na, de toute forme d'alliance ? Le « principe-désir », nous dit Cai Hua, incitant à la possession du partenaire ou, à son contraire, la multiplication des relations. Une société ne peut institutionnaliser que l'une de ces modalités contradictoires en inhibant l'autre. On a donc des « sociétés à mariage » et, en l'état actuel des connaissances, une seule « société à visite », celle des Na. Posséder ou multiplier, il faut choisir ses lois du désir.(Nicole Lapierre, Le Monde, 12 septembre 1997)
Document n° 5 : Les appellations de parenté
Un des outils de l'ethnologue pour comprendre les systèmes de parenté et les structures de l'échange matrimonial est la terminologie(…) La terminologie est un véritable langage qui classe les parents en catégories et sous-catégories. En apprenant les termes de parenté, l'enfant apprend à se conduire d'une manière appropriée vis-à-vis des personnes auxquelles s'appliquent ces termes. Le terme de parenté est pratiquement une étiquette sur laquelle on peut fixer une conduite basée sur le respect ou la familiarité, l'affection ou l'hostilité, les droits et/ou les devoirs, la plaisanterie ou l'évitement, etc. Nous avons vu que les mariages prescrits et prohibés se rapportent le plus souvent aux termes de parenté. Les structures matrimoniales ont ainsi des correspondances dans la terminologie, notamment lorsqu'elles distinguent les consanguins que l'on peut épouser de ceux que l'on ne peut pas épouser (comme les cousins parallèles qui, dans la moitié d'Ego, sont des « frères » et des « soeurs », alors que les cousins croisés de sexe opposé, dans l'autre moitié, sont des « époux potentiels »). (…)
La dénomination des soeurs, cousines parallèles et cousines croisées bilatérales pour Ego masculin peut être représentée de la façon suivante :
Hawaïen : soeurs = cousines parallèles = cousines croisées bilatérales
Eskimo : soeurs #cousines parallèles = cousines croisées bilatérales
Iroquois : sœurs = cousines parallèles # cousines croisées bilatérales
Crow/omaha : soeurs = cousines parallèles # cousines croisées (patrilatérales # matrilatérales)
Soudanais : soeurs # cousines parallèles # cousines croisées (patrilatérales # matrilatérales)
(Christian Ghassarian : « Introduction à l’analyse de la parenté » - Point Seuil)
Document 6 : Pour l'anthropologue, qu'est-ce que signifie "être élevé"?
Il y a sept fonctions à la "parentalité", qui sont universelles. Même si, selon les systèmes familiaux, différentes personnes les exercent. La première fonction est de concevoir et d'engendrer. Cela semble simple chez nous les Occidentaux, un homme et une femme couchent ensemble. Mais c'est déjà plus compliqué quand il y a des mères porteuses et qu'il faut deux femmes pour faire un enfant. Dans des sociétés patrilinéaires, comme en Nouvelle-Guinée, c'est le sperme de l'homme qui est considéré comme seul fabriquant l'enfant. Dans d'autres, matrilinéaires, c'est la femme, son sang menstruel, avec l'aide d'un esprit qui font l'enfant. Dans le premier cas, l'enfant appartient au clan du père, dans l'autre, au clan de la mère et de ses frères… Vous voyez le rôle des représentations, qui n'ont rien de scientifique, mais qui relèvent de logiques sociales et de pouvoir. Dans la plupart des sociétés, on ne pense pas qu'un rapport sexuel suffise pour faire un enfant. L'idée générale est qu'il faut être trois. Les Baruya pensent que c'est le soleil qui finit le fœtus dans le ventre des mères. Dans d'autres sociétés, ce sont les ancêtres qui jouent ce rôle. Chez les chrétiens aussi, il faut être trois! Car qu'est-ce qui introduit l'âme dans le fœtus ? Ce n'est pas le sperme de l'homme. Elle est introduite par Dieu. Dans le christianisme, malgré toutes nos connaissances en biologie moléculaire, il faut être trois pour faire un enfant. Pareil pour l'islam…
La deuxième fonction de la parentalité? Donner un nom. Dans toute société, un enfant qui n'a pas de nom n'existe pas. Dans les sociétés patrilinéaires, c'est un nom appartenant au clan du père. Chez les Baruya, un enfant, pendant sa première année, ne voit quasiment pas son père. S'il meurt cette année-là, il est enterré n'importe où. Puis, s'il survit à sa première année, le clan du père lui donne un nom et il entre dans le groupe. Sans nom, un enfant n'est pas complet. La troisième fonction consiste à "s'occuper de", c'est-à-dire nourrir, soigner et protéger. La quatrième fonction est celle de la "formation". Chez nous, l'école ou le service militaire, quand il existait, ont pris cette place. Mais dans beaucoup de sociétés, des adultes devaient prendre en charge la formation des enfants pour en faire des guerriers, des chamans… La cinquième fonction, c'est, pour certains parents, d'exercer une forme d'autorité sur les enfants. Toutes les gammes d'autorité sont possibles. Il y a des sociétés extrêmement permissives où l'enfant est roi et on ne le réprime jamais, et d'autres très strictes où les enfants ne peuvent quasiment pas prendre la parole. La responsabilité va avec. Si votre enfant casse un carreau, c'est à votre charge. C'est pareil dans toutes les sociétés. «"Le modèle chrétien est un horizon de culture, mais il n'est déjà plus une norme sociale générale depuis la Révolution française." »
La septième et dernière fonction de la parentalité? Certains parents qui ont la charge des enfants ne peuvent pas avoir de rapports sexuels avec eux. Ce sont les deux tabous de l'inceste, le tabou homosexuel que l'on oublie toujours (un père et un fils, une mère et une fille) et le tabou hétérosexuel que tout le monde connaît. Ces tabous sont universels, même s'ils varient. Dans l'Antiquité, en Perse ou en Égypte, le mariage "idéal" était entre un frère et une sœur, à l'imitation des dieux. L'inceste détruit les rapports de solidarité et d'autorité au sein des familles ainsi que les rapports d'alliances entre les familles. Finalement, être "parent", c'est assumer ces sept fonctions. Selon les sociétés, ce ne sont pas les mêmes personnes qui s'en occupent. Cela dépend du système de parenté…
Combien existe-t-il de systèmes de parenté? En gros, actuellement sur terre, 10.000 groupes exercent une souveraineté sur un territoire, des personnes et des ressources. Cela fait 10.000 sociétés, même si certaines comptent 50 personnes en Amazonie et qu'il y a 1,3 milliard de Chinois. Ces 10.000 sociétés ont toutes un système de parenté qui leur est propre. Nous, nous sommes dans un système dit "indifférencié". On retrouve ce même système chez les Inuits ou en Indonésie. Il est apparu en Europe à la fin de la République romaine. Nous n'avons qu'un seul père et une seule mère. Ce système romain a été "encapsulé" par le christianisme. Plus tard, dans le christianisme, le mariage est devenu un sacrement. L'union d'un homme et d'une femme devant Dieu, avec interdiction du divorce, interdiction de relations sexuelles en dehors du mariage, interdiction de se masturber aussi, etc. L'Église a détruit la polygamie. Mais notre système n'est pas du tout majoritaire dans le monde! La Chine, l'Inde, et cela fait plus de deux milliards d'individus, fonctionnent autrement! (Maurice Godelier : "L'Occident vit une refondation, comme pendant la Renaissance")
Document 7 : Les opposants au projet de loi sur le mariage homosexuel parlent d'"aberration anthropologique", qu'en pensez-vous ?
Cela n'a aucun sens. Dans l'évolution des systèmes de parenté, il existe des transformations mais pas des aberrations. Certes, on ne trouve pas, dans l'histoire, d'union homosexuelle et homoparentale institutionnalisée. On comprend pourquoi. Pendant des millénaires, la société a valorisé l'hétérosexualité pour se reproduire. Mais souvent l'homosexualité au sein des sociétés a été reconnue dans la formation de l'individu, en Grèce antique par exemple. J'ai vécu sept ans dans une tribu de Nouvelle-Guinée, les Baruya, où, pour être un homme, il fallait être initié. Les initiés vivaient en couple homosexuel jusqu'à 20 ans. L'homosexualité avait un sens politique et religieux. Mais la question des unions homosexuelles et de l'homoparentalité est une question moderne, qui ne s'est jamais posée auparavant. L'humanité n'a cessé d'inventer de nouvelles formes de mariage et de descendance. C'est pour cela que je parle de métamorphoses à leur propos. Aujourd'hui, en Occident, les deux axes sur lesquels repose tout système de parenté, l'alliance et la descendance, intègrent des formes nouvelles. Pourquoi maintenant ? C'est le résultat de quatre évolutions indépendantes. La reconnaissance progressive que l'homosexualité est une sexualité autre mais normale, l'émergence d'un nouveau statut de l'enfant, l'apparition de nouvelles technologies de la reproduction, et le fait que dans une démocratie les minorités peuvent revendiquer des droits nouveaux. A partir de là, il est devenu possible et nécessaire d'accorder aux homosexuels de vivre légalement leur sexualité et, pour ceux qui le désirent, de pouvoir élever des enfants. (…) Chez les Baruya, chaque individu a plusieurs pères et plusieurs mères. Tous les frères du père sont considérés comme des pères, toutes les sœurs de la mère comme des mères. Est-ce que toutes les autres familles que celles de l'Occident post-chrétien sont irrationnelles? C'est l'humanité qui les a inventées ! Les résistances sont normales, elles accompagnent un grand changement social et mental. Deux personnes de même sexe vont avoir des enfants, alors que l'exigence de la nature c'était qu'il fallait deux personnes de sexe différent pour concevoir. Toutes les sociétés ont trouvé des parades à la stérilité. Nous avons la procréation médicalement assistée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les notions de paternité et de maternité ont deux dimensions, biologique et sociale. Dans l'histoire, la plupart des sociétés ont mis en avant le social. La nôtre tend à l'inverse. Mais aujourd'hui, au sein des familles recomposées, la parenté sociale s'étend. On attend du nouveau compagnon ou de la nouvelle compagne qu'ils se comportent comme des pères et des mères vis-à-vis des enfants conçus par d'autres. ("L'humanité n'a cessé d'inventer de nouvelles formes de mariage et de descendance" - Entretien avec Maurice Godelier, Le Monde - 17.11.2012 - Propos recueillis par Gaëlle Dupont)
|
Document 8 : Mariage homo et homoparentalité Existe-il des sociétés où l’union de couples homosexuels est avérée ? N’est-ce pas une forme de pis-aller, à l’exemple des Azandés du Soudan ? Il faut se méfier de la manière formelle de présenter les choses… Dire cela de cette manière peut entraîner de nombreuses critiques, car cela serait compris comme une prise de position contre le PACS. J’ai connu ces critiques, alors qu’elles ne reflétaient pas ma position sur cette question. Ce qu’il faut admettre, c’est qu’il n’y a pas de société connue qui reconnaisse l’existence d’unions homosexuelles de même valeur que les unions hétérosexuelles. A cela, il y a plusieurs raisons. La principale est que l’union hétérosexuelle s’opère dans le but d’avoir des enfants, qu’elle est le garant de rapport harmonieux entre deux familles, qui deviennent un élément du couple et qui établissent entre elles des relations consanguines. Néanmoins, il existe des cas, peu fréquents mais reconnus, où des unions homosexuelles ont pu être validées de façon plus ou moins temporaire. Dans certaines sociétés indiennes d’Amérique du Nord, certains comportements transsexuels sont ainsi reconnus. C’est le cas notamment de ceux que l’on nomme les Berdaches. Au sein de ces sociétés, des individus de sexe masculin sont habillés en femmes, ils ont le comportement des femmes - comme les Rae Rae à Tahiti - et peuvent vivre avec des hommes de façon au moins temporaire. Dans ce cas de figure, les Berdaches se comportent comme les épouses. Ainsi, ce type d’union qui peut être qualifiée d’homosexuelle existe, mais elle n’a pas le même statut qu’une union hétérosexuelle. Elle est considérée comme une possibilité d’expression de l’individu. S’il n’est pas réprouvé ou interdit d’être un Berdache, cela n’est pas non plus recommandé. Par ailleurs, l’union d’un homme avec un Berdache ne peut être que transitoire, puisqu’à la fin il doit avoir une épouse et des enfants.(…) Des cas de figures similaires peuvent se retrouver dans des sociétés d’Afrique de l’Est ou d’Océanie. Ainsi, il s’agit de formes d’organisation sociales sociologiquement admises. Elles ne sont toutefois pas assimilées au mariage durable à vie : elles ne sont ni réprouvées ni valorisées, mais elles existent. Il a également existé des cas d’unions homosexuelles entre femmes dans des sociétés d’Afrique de l’Est telles que les Nuers, sociétés qui n’existent plus désormais. Elles ont été étudiées par Evan Pritchard dans les années 1950. Il ne s’agissait pas d’unions homosexuelles reconnues comme telles, mais elles traduisaient la possibilité de changer de statut économique et social pour les femmes ayant fait la preuve de leur stérilité, au bout d’un certain nombre d’années de mariages sans enfants. Dans ces sociétés, l’existence de ces femmes stériles était considérée comme une erreur de la nature. Ces femmes étaient alors assimilées à des hommes dans des corps féminins. Celles qui revenaient dans leur village d’origine se trouvaient donc incluses dans leur lignage au même titre que les hommes et pouvaient bénéficier d’une redistribution des compensations matrimoniales que les hommes recevaient pour leurs filles et leurs nièces. En effet, le don d’une fille en mariage à une autre famille entraînait des compensations financières, souvent en nature, qui se trouvaient réparties entre le père et les oncles de la fille en question. Le statut de l’épouse était d’abord celui de la personne pour laquelle une compensation financière a été versée. Les femmes stériles retournées au village participaient à cette redistribution avec le statut d’oncle. Quand elles avaient accumulé assez de compensations matrimoniales, elles pouvaient à leur tour se « payer » une épouse. Les épouses ainsi « achetées » par les femmes stériles devaient alors se comporter en tout point comme une épouse normale, à ceci près que, pour Pritchard, il n’y avait certainement pas de relations sexuelles entre les deux femmes. La femme qui « achetait » ainsi une épouse était en droit de vouloir faire fructifier son « bien ». Cela impliquait que l’ « achetée » travaille pour elle, mais aussi qu’elle ait des enfants. A cette fin, des esclaves étaient appointés pour effectuer le travail du lit : ils étaient à ce titre rémunérés en nature. Les enfants qui naissaient ensuite étaient reconnus comme issus de l’«acheteuse ». Ainsi, si l’existence d’unions homosexuelles est reconnue, celles-ci n’ont jamais la même valeur que les unions hétérosexuelles. (…) A l’aube de l’humanité, tout se passe dans ces groupes consanguins quand arrive l’idée qu’il vaut mieux s’entendre que se faire tuer. Pour Taylor, l’humanité a du choisir entre se faire tuer à l’extérieur ou se marier à l’extérieur. Il a fallu alors mettre en exergue dans les esprits humains la prohibition de l’inceste : on ne touche pas à ses proches sexuels. Un homme ne touche pas à sa fille car il la donne à un autre groupe contre une des filles de ce groupe. Cet échange est au fondement de la valence différentielle des sexes : les hommes ont la possibilité de disposer des femmes. L’institution du mariage créé un rapport durable entre les deux groupes entre lesquels de met en œuvre la répartition sexuelle des tâches. De plus, le mariage désigne un rapport entre groupes, et pas seulement entre individus. Ceci est toujours le cas et se voit dans le fait que le mariage est le seul contrat à mobiliser les familles. Il s’agit toujours d’une occasion festive où les deux familles se rencontrent. De nouvelles rencontres et de nouvelles alliances peuvent par ailleurs être conclues à l’occasion de ces cérémonies. Même s’il est un choix individuel, le mariage est perçu comme un accord entre deux familles. (…) La découverte du lien génétique entre spermatozoïdes et ovules est assez récente et ne date que de la fin du XVIIIème siècle. Avant, les tentatives de réponse à la question du choix génétique renvoyaient aux mythes. Ces réponses étaient généralement d’une grande simplicité. Les femmes n’auraient pas une puissance intime ou une supériorité. Elles enfanteraient des êtres de sexe différents car des éléments différents seraient introduits dans leurs corps. Les sociétés sont ainsi partagées en deux modèles explicatifs. Dans le premier, les femmes n’y seraient pour rien dans la venue d’un enfant sexué. Elles auraient déjà une dotation dès la naissance, telles des « graines », graines qui viendraient à maturité en étant « arrosées » par le sperme. C’est le cas par exemple chez les Samos. Dans le second, les femmes ne seraient qu’un véhicule, qu’un matériau, une « marmite » où se fait une mission qui va faire des enfants. Le sperme apporte la possibilité d’avoir des enfants, avec un esprit, une idée, un nom, un « pneuma ». Le corps de la femme ne serait qu’un lieu de passage. Ce modèle aristotélicien est celui que l’on transmet toujours aujourd’hui. De par cette capacité et cette asymétrie biologique, les femmes se trouvent dépossédées de leur corps. Dans un système d’interprétation sociologique, les femmes se trouvent assignées à ne faire que cela. (…) (Compte-rendu d'entretien avec Françoise Héritier - http://sciencespo2005.free.fr/anthropologie/francoise_heritier.php) |
Document 9 : importance de la filiation
relativiser la grandeur. Or, nous l'avons montré, les principes qui déterminent la descendance sont tout aussi culturels et « artificiels » que les règles de l'alliance. Que l'on descende par les hommes ou par les femmes, que ce soit le sperme ou le sang menstruel coagulé de la femme qui fasse le foetus, que pour ces raisons les enfants appartiennent au clan de leur père ou à celui de leur mère, ou aux deux clans mais pour d'autres raisons, il n'y a là aucune logique biologique à l'oeuvre. Ce ne sont là que constructions culturelles, représentations imaginaires des processus de la vie. Et, par ailleurs, c'est principalement le long de l'axe de la descendance que les groupes transmettent ce qu'ils ont gardé pour les générations qui leur succéderont. Et même quand les mariages détachent et dispersent des morceaux d'un patrimoine, les stratégies de ré-enchaînement des alliances, au terme d'un certain nombre de générations, ramènent sur l’axe de la descendance ce qui s'en était séparé, ou un équivalent actualisé. (…) En fait, l'évolution des rapports de parenté dans les sociétés occidentales depuis une vingtaine d'années, montre que ce qui reste le plus stable deux axes de la descendance et de l'alliance qui se combinent pour produire les rapports de parenté, c'est la descendance et l'attention apportée par lacs sociétés à ce que l'avenir des enfants ne dépende plus entièrement de l’évolution des rapports entre leurs parents. Ceux-ci peuvent se séparer, divorcer, se remarier, avoir l'un la garde des enfants une semaine, l'autre la semaine suivante, la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants qu'ils ont mis au monde demeure la même aux yeux de la société, personnifiée par l'État, quels que soient les conflits qui les opposent et les conditions de leur séparation. Bien entendu, l'enjeu — sauf dans certaines classes — n'est pas d'abord, comme dans les siècles précédents, la transmission d'un et d'un patrimoine. Aujourd'hui, l'enfant et l'enfance ont revêtu une signification et une valeur nouvelles liées à l'importance de la défense des droits de l'homme dans une société démocratique. Les enfants ont des droits face à leurs parents. Alors que les formes d'alliance se diversifient — unions libres, concubinage, etc. — et n'ont plus rien à voir avec celles des époques où le mariage (en Europe) était un sacrement qui ne pouvait être rompu que par la mort du conjoint, l'axe de la descendance demeure le lien social où le jeu des droits et devoirs réciproques entre parents et enfants est le plus ferme dans la plupart des classes sociales. Et l’avenir des études de la parenté exige qu'on prête désormais autant d’attention aux jeux de la descendance qu'à ceux de l'alliance. (…) (Maurice Godelier : « Lévi-Strauss » - bilan de la première partie « La parenté » - Seuil -2013)
Document 10 : Dernière sortie hors de l'Occident et loin de notre temps. À la découverte des « abominations » des anciens Égyptiens et Iraniens
« Si nous ne connaissions pas la coutume du mariage entre frère et sœur chez les Égyptiens, nous affirmerions, à tort, qu'il est universellement reconnu que les hommes ne peuvent épouser leur sœur 86. » (Sextus Empiricus, philosophe et physicien grec,IIème siècle ap. J.-C.)
Les Na nous ont fourni l'exemple d'une société où existent des échanges (de sperme) entre matrilignées sans que ces échanges soient l'occasion de fonder des alliances et donc de se faire des alliés. En allant visiter les anciens Égyptiens, nous découvrons une société où, pendant des siècles, on a trouvé normal que des frères et soeurs se marient ensemble et où on encourageait même fortement de tels mariages, ceci non seulement au sein des familles dynastiques, mais aussi parmi les autres couches de la population. Ainsi, un nombre très important de mariages, dans la mesure où ils unissaient deux consanguins les plus proches l'un de l'autre, constituaient des alliances sans échange, à l'inverse des Na qui, eux, pratiquaient des échanges sans alliances. Mais les Égyptiens, eux non plus, en se mariant au sein de leur propre famille, ne se créaient pas de nouveaux alliés. (…)En Iran, les mariages xwêtôdas entre consanguins les plus proches, bien loin de disparaître sous l'effet des sectes chrétiennes, furent restaurés et consolidés dès la fin du IIIè siècle (…)Les mariages xwêtôdas les plus parfaits sont ceux qui s'établissent « entre père et fille, fils et celle qui l'a porté, frère et soeur ». Xwêtôdas est un mot de l'époque sassanide dérivé de l'iranien ancien (avestique) xwaêtvadatha, qui signifiait mariage (vadatha) au sein des kwaêta (famille, lignage). Plusieurs kwaêta formant un clan (probablement patrilinéaire), plusieurs clans une tribu. Donc, le mariage parmi les siens (kwaê = sien) recouvre probablement à la fois le mariage avec les soeurs mais aussi avec les filles des frères du père, les cousines parallèles patrilatérales. Mais du fait qu'on pouvait épouser sa soeur, on pouvait peut-être aussi épouser les filles de la soeur de la mère. Les mariages xwêtôdas sont doublement légitimés par la cosmogonie et la théologie mazdéennes pour les raisons suivantes. D'abord, ils reproduisent les actes des divinités qui créèrent le monde. Ils garantissent le paradis à ceux qui le contractent. Ils écartent ou tuent les démons et renforcent les puissances du Bien dans l'univers. Ils sont une obligation pour les fidèles du mazdéisme. Ces mariages, en effet, reproduisent les actes fondateurs du cosmos et de l'humanité, qui sont issus d'une triple union entre un père et sa fille, un fils et sa mère, et entre les deux jumeaux qui furent le couple humain primordial. La première union fut en effet celle d'Ohrmazd, maître du Ciel, et de sa fille, Spandarmat, la Terre. De leur union naquit un fils, Gayomât, un géant qui s'accoupla avec sa mère, la Terre. De leur union naquirent Mashya et Mashyani, les deux jumeaux qui s'unirent à leur tour dans le désir d'avoir un fils. Tous les humains sont donc nés de ces trois xwêtôdas. (…) On aura compris que, bien loin d'être interdit aux yeux du commun et pratiqué seulement par une élite, le mariage frère-soeur était, aux yeux des Iraniens anciens, l'union la plus valorisée, la plus sacrée. Cette union ne pouvait être célébrée qu'avec l'aide d'un prêtre, d'un mage qui avait lui-même contracté un mariage xwêtôdas. Et l'on comprend également que les références aux unions xwêtôdas étaient présentes dans les grands rites saisonniers et les sacrifices qui reproduisaient chaque année les différents moments de la création du monde, issu de l'union du père de tous les dieux et de tous les humains, Ohrmazd, et de sa fille et épouse, Spandarmat, la Terre mère. Nous sommes ici aux antipodes de la parenté chrétienne. Au lieu de prescrire l'union de deux individus de sexe différent dans lesquels toutes traces de liens de consanguinité ou d'affinité préexistants auraient disparu ou n'auraient jamais existé, les Iraniens prescrivent l'union entre les deux consanguins les plus proches. Dans la parenté chrétienne, en s'unissant sexuellement, un homme et une femme qui satisfont à tous les critères imposés par le christianisme pour se marier, n'en transmettent pas moins, sans le vouloir et sans pouvoir l'éviter, la faute originelle commise par le couple originaire dont est issue toute l'humanité, un couple qui n'était pas celui de jumeaux mais fait d'un être, Adam, un être masculin, divisé en deux par la volonté de Dieu pour fabriquer Ève, la première femme. À l'opposé, les anciens Iraniens faisaient de l'union d'un frère et d'une soeur le mariage idéal, celui par lequel les humains prolongent et reproduisent la création divine de l'univers et de l'humanité, un mariage qui, au lieu de les précipiter en enfer, était leur meilleure arme pour combattre les démons et les faire accéder au paradis. Le mariage xwêtôdas, frère-soeur, était donc le mariage idéal pour tous les humains. (…) Tirons de ces analyses quelques remarques théoriques de portée générale. Résumons. La plupart des sociétés antiques du pourtour méditerranéen et du Proche-Orient combinaient deux principes, deux stratégies pour assurer la continuité et le développement des groupes de parenté qui les composaient : se marier au plus proche de soi, chez soi, ou s'unir à d'autres groupes plus ou moins distants de soi, mais de statut équivalent ou, mieux encore, de statut supérieur. Des mariages entre un frère et une demi-soeur, agnatique ou utérine, entre oncle et nièce, étaient courants, pour ne rien dire des unions avec des parentes un peu moins proches, les filles du frère du père et d'autres sortes de cousines. Parmi ces sociétés, les Égyptiens et les Iraniens sont allés plus loin encore dans la pratique des mariages proches en autorisant et en privilégiant même les mariages entre frères et soeurs, et en Iran entre frère et soeur, père et fille (très rares) et mère et fils (plus rares encore). Mais même dans ces sociétés les mariages avec des parents lointains ou des non-parents ont toujours existé et constituaient probablement la majorité des unions. (…) (Maurice Godelier : Métamorphoses de la parenté » - Champs Flammarion – 2010 - p 510 à 519)
Document 11 : sexe et genre chez les Inuits
(…) Une étude approfondie des mythes d’origine révéla aussi que la différenciation des sexes constituait la première grande différenciation de la cosmogénèse inuit. Cette différenciation est, d’ailleurs, également conçue comme un moment essentiel dans la reproduction de la vie humaine. De nombreux récits illustrent ces croyances : les Inuit pensent qu’un foetus peut changer de sexe en naissant. On appelle sipiniit (du radical verbal -sipi qui veut dire se fendre) les individus dont on pense que le sexe a changé à la naissance. Dans les deux tiers des cas, il s’agit d’une transformation de garçon en fille. Parmi les symptômes associés à ce « transsexualisme » on mentionne un accouchement long et difficile, un oedème génital assorti d’ambiguïté génitale chez le nouveau-né (on a de la difficulté à reconnaître son sexe) et enfin un sexe obstrué par des mucosités entraînant une incapacité d'uriner, dans les moments qui suivent la naissance. Plusieurs accoucheuses inuit affirment avoir vu le pénis et le scrotum de nouveau-nés se résorber et donner place à une fissure vulvaire dans les tissus du périnée. (…)J’ai mentionné plus haut comment l’identité d’un nouveau-né était déterminée par l’attribution de ses noms. Le choix était opéré par ses ascendants et visait à permettre aux défunts de revivre parmi les êtres qui leur étaient chers. Les ascendants choisissaient le nom de parents ou d'amis dont l’absence les affectaient le plus. Quand un nouveau-né éprouvait quelque difficulté à vivre, dans les premiers jours suivant sa naissance, c’était le signe qu’un défunt voulait revivre en lui ; ce désir devait être satisfait pour assurer la survie de l’enfant. Le rêve était une autre voie d’accès à la volonté des défunts. Quand un mort se manifestait en rêve à quelqu'un, sous la forme d’une visite ou d’une demande à boire, c’était le signe qu’il désirait renaître dans sa famille. Le caractère aléatoire et imprévisible de la mort, et donc du sexe du prochain défunt, combiné à celui du moment de la naissance et du sexe des enfants à naître, entraînait un nombre relativement élevé de nouveau-nés (de 15 à 20%) avec un sexe différent de celui de leur ancêtre éponyme. Ces cas étaient l’objet d’un investissement symbolique qui pouvait prendre différentes formes, regroupées ici sous le terme de « travestissement » (qu’il s’agisse de l’utilisation de termes de parenté, de taille ou d’arrangement des cheveux, de vêtements ou de parures, d’outils ou de techniques, de gestes ou de postures du corps, normalement réservés à l’autre sexe). Comme souvent les enfants recevaient plus d’un nom, et donc plusieurs identités, d’éponymes de sexes différents, ils vivaient sous des identités multiples qui coexistaient ou alternaient dans le temps. Elles coexistaient lorsqu’ils portaient en même temps des attributs des deux sexes, elles alternaient lorsqu’ils portaient selon les circonstances, ceux d’un sexe ou ceux de l’autre. (…) Un quatrième facteur, le rapport numérique des sexes dans une famille (sex-ratio familial), opérait lorsque le sexe du nouveau-né contrariait l’attente des parents. Ceci était fonction de son rang de naissance et du sexe relatif des autres enfants de sa fratrie. Dans les fratries sans garçon ou sans fille, il n’était pas rare que des enfants fussent travestis et éduqués de façon inversée, en vue de seconder le parent du sexe opposé. (…). En effet, s'il est à peu près équilibré dans toutes les populations du monde, le sex ratio à la naissance est très variable à l’échelle de la famille. En cas de déséquilibre, les Inuit recourraient à l’adoption ou à la socialisation inversée, en particulier quand les premiers enfants étaient des filles. On jouait alors à fond sur l’éponymie et on travestissait la fille, en l’initiant aux tâches masculines. Une fille, aînée ou cadette, était ainsi souvent socialisée de façon inversée, jusqu’à ses premières menstruations, que l’on célébrait comme si elle avait tué un gros gibier (alors qu’en situation normale on aurait prétendu qu’elle avait eu un fils) ; elle devait, à compter de ce jour, porter des vêtements féminins. Symétriquement, dans une fratrie de garçons, un cadet était souvent travesti et socialisé comme une fille, jusqu’à ce qu’il tue son premier gros gibier. Il devait alors couper ses tresses et s’habiller en garçon. Dans les cas où le déséquilibre des sexes n’était pas le facteur déterminant du travestissement ou de la socialisation inversée, des raisons plus symboliques et affectives étaient invoquées pour en déterminer le degré. Les Sipiniit, décrits plus haut, étaient habituellement travestis au plus haut degré. Si nous passons maintenant des modalités du travestissement à ses effets sur ceux qui le subissaient, il y a unanimité des témoignages pour souligner les difficultés et souffrances morales éprouvées par les travestis et les socialisés inversés, quand ils devaient adopter, à la puberté, les vêtements, outils et tâches affectés habituellement à ceux qui avaient leur sexe biologique. Ils étaient rarement aidés par leurs parents proches, qui avaient justement décidé de leur travestissement, participé à leur socialisation, et qui continuaient d’ailleurs à utiliser les termes de parenté requis par l’éponymie. Le fait d’avoir à se soumettre à une autre réalité que celle de leur enfance, constituait une véritable crise pour ces adolescents, avec ses heurts et ses révoltes. Ce n’est que lentement et progressivement qu’ils parvenaient à acquérir les aptitudes des gens de leur sexe et, leur vie durant, ils restaient marqués par leur première éducation et par le chevauchement de la frontière des sexes. Ce chevauchement était devenu une composante de leur personnalité et faisait d’eux une catégorie à part, que j'ai proposée d’appeler le « troisième sexe social ». On les valorisait en général beaucoup en raison de leur polyvalence, de leur autonomie, mais aussi d’un pouvoir de médiation particulier qui s’exprimait notamment dans le domaine religieux. (…) (Bernard Saladin D’Anglure : “Le « troisième sexe ».” - La Recherche, no 245, juillet-août 1992)
Document 12 : Parenté et nouvelles techniques biologiques
Contraception, avortement, stérilisation (…) Poussées par les mouvements féministes en Occident (« un enfant si je veux, quand je veux »), les méthodes contraceptives modernes ont pris une ampleur nouvelle depuis une trentaine d'années. Elles transforment de nombreuses données culturelles, notamment avec la multiplication des couples sans enfants. L'avortement, qui a contribué à libérer la femme de la contrainte de la procréation, a toutefois commencé à faire l'objet d'un usage « détourné » qui se rapporte au système de valeurs de la société dans lequel il est pratiqué. En Inde, le diagnostic prénatal (l'amniocentèse) déterminant le sexe est depuis quelques années utilisé par les parents (avec la complicité du médecin) comme un moyen pour rejeter le foetus 1 féminin. La naissance d'un fils est en effet fortement valorisée j religieusement, culturellement et économiquement — la dot coûte cher. Le gouvernement ferme les yeux sur cette pratique car l'avortement sert sa politique de contrôle des naissances (Francis, 1992). Cet avortement sélectif, qui commence déjà à poser un problème d'équilibre des sexes dans le pays, est aussi pratiqué en Chine (Qui, 1992). (…)
Les nouveaux modes de reproduction Les applications des découvertes biotechnologiques dans le domaine de la reproduction humaine expriment la valorisation du développement scientifique et technique et une foime moderne d'humanisme valorisant l'individu dans sa capacité à maîtriser son destin (Laborie, 1991). La possibilité pour un couple d'avoir ou de ne pas avoir un enfant participe d'une révolution à la fois biologique, éthique et sociale. Résultant de la logique du contrôle des choses, le développement de la procréation médicalement assistée (PMA en France) dans les armées soixante est venu relancer l'espoir des couples stériles d'avoir un enfant qui leur soit biologiquement relié plutôt que de recourir à l'adoption. L'insémination artificielle peut avoir diverses causes et peut prendre diverses formes. Cette technologie a engendré la création de centres d'étude et de conservation du sperme, plus communément appelés « banques du sperme ». (…)
Bioéthique L'évolution de la biologie et l'apparition des nouveaux modes de reproduction (NMR en France) ouvrent des voies inédites et posent de nombreuses questions que ne pose pas l'adoption. Ces technologies introduisent de profonds bouleversements dans des repères culturels. Si, dans le cas de l'adoption, il est clair que les parents sociaux ne sont pas les géniteurs, la fécondation avec transfert d'embryon, à travers le don d'ovules et le prêt d'utérus, peut impliquer biologique-ment trois personnes dans la conception et l'engendrement d'un enfant. L'institutionnalisation et la légitimation des nouveaux modes de reproduction engendrent par ailleurs des demandes et des situations d'un nouveau type. Le 18 juillet 1994, en Italie, une femme a battu le record de l'accouchement tardif en donnant naissance à un enfant à soixante-deux ans. Des personnes seules et des couples homosexuels peuvent désormais « faire » un enfant en refusant l'hétérosexualité. La perspective peut varier mais le résultat pratique est le même : le lien biologique avec un enfant obtenu par insémination artificielle avec donneur (s'il s'agit d'un couple de femmes) ou avec une mère de substitution (s'il s'agit d'un couple d'hommes) ne se fait qu'avec l'un des deux parents pour le couple hétérosexuel et il peut se faire avec l'un des deux parents pour le couple homosexuel.(…) Ni les biologistes, ni les médecins, ni les morales traditionnelles ou laïques ne sont en mesure de résoudre les nouveaux problèmes éthiques, économiques, juridiques et politiques que pose l'avancée de la biomédecine. Face aux nouvelles méthodes de reproduction, il n'y a pas de consensus de la morale collective et les sociétés fournissent différentes réponses et différentes législations. L'hétérogénéité des comportements et des représentations, des discours et des pratiques, apparaît d'ailleurs non seulement entre les divers pays mais aussi à l'intérieur de chaque pays. Les réponses éthiques proposées par l'État et les organisations religieuses diffèrent souvent. Certaines autorités religieuses (l'Église catholique notamment) rejettent la fécondation in vitro, d'autres (les diverses Églises protestantes) parlent d'un acte d'amour quand elle unit la semence de l'époux et l'ovule de l'épouse et permet à ce couple d'avoir un enfant qui est « le leur » (ce qui traduit l'emphase idéologique mise sur le lien biologique). La disparité des attitudes apparaît également à propos des expériences sur les embryons humains, qui sont interdites ici, autorisées sous certaines conditions là et permises sans réserves ailleurs. Les recherches sur le développement embryonnaire perturbent particulièrement les conceptions communes. (…) Des questions éthiques inédites surgissent, comme celle de savoir si l'embryon est une « personne humaine » (en Allemagne), une « personne humaine potentielle » (en France), etc. Quel statut donner aux embryons congelés, cette forme inédite de l'humain ? « Faut-il les garder pour une autre grossesse du même couple, les faire adopter en quelque sorte par un autre couple, les tuer, s'en servir pour des expériences ? Aucune solution n'est bonne » (Bernard, 1991, 146). Quelle est par ailleurs la relation entre les embryons congelés et le donneur et/ou la mère de substitution ? L'embryon est-il concerné par les questions de filiation ? La définition de l'embryon varie en fait de pays à pays (« oeuf fécondé », « pré-embryon », « embryon »). En France, le terme s'applique à toutes les phases du développement de l'oeuf, ou zygote, depuis la fécondation de l'ovule jusqu'au stade foetal, qui est atteint à la huitième semaine de la grossesse. (…)
Lien social et lien biologique Les nouveaux modes de reproduction posent la question de [a conception de l'humain et de la filiation. La contribution scientifique des ethnologues au débat sur les nouveaux modes Je reproduction ne peut s'opérer que dans « la stricte mesure où le savoir sur la parenté et les filiations comporte des impli:ations générales, quant aux contraintes organisationnelles rt aux mécanismes symboliques » (Menget, 1989b, 124). Les combinaisons possibles de la filiation sont en nombre fini et dans toutes les sociétés humaines la filiation (et les liens de solidarité et d'affection qui en découlent) ne dérive jamais simplement de l'engendrement. Où se trouve en effet la « vraie » filiation biologique dans certains cas ? L'ovule, le matériel génétique, de l'une est-il plus « vrai » que l'utérus de celle qui porte l'enfant et le mène au terme de l'accouchement ? « La partition des faits entre le licite et l'illicite, le normal et l'anormal, le naturel et l'artificiel [...] est toujours affaire de convention sociale » (Héritier, 1985, 6). L'étude des systèmes de parenté montre que les sociétés consacrent la primauté de la convention juridique sur le biologique. L'institution de l'adoption témoigne du fait que la filiation est purement conventionnelle. Il est d'ailleurs révélateur que la plupart des systèmes sociaux (y compris le Code civil français) placent un interdit d'inceste entre adoptés et adoptants. Le cas des enfants dits « naturels » ou « illégitimes » montre d'ailleurs que l'on peut réfuter juridiquement les liens du sang. (…)L'expansion des nouveaux modes de reproduction, basée sur le désir que l'enfant ait un lien génétique avec au moins l'un des deux parents, traduit une certaine revalorisation du rapport biologique en tant que constituant du lien social en Occident. Le phénomène n'est pas nouveau. Dans son histoire des définitions successives de la parenté, Schneider (1984) a démontré que les sociétés occidentales adhèrent à un biologisme spontané en vertu duquel les liens du sang justifient les sentiments, les obligations et les attentes entre parents et enfants. Cette référence à la biologie apparaît dans l'emploi des termes « réels » ou « vrais » à propos des parents biologiques. Dans sa psychanalyse du droit canon, Legendre (1988) a également décelé la notion de biologie enfouie dans l'inconscient et les discours sur le mariage et la filiation dans le modèle chrétien (notamment la longue interdiction de l'adoption par l'Église, qui a restreint les liens de parenté fondés sur le mariage et la filiation aux faits strictement biologiques). La revalorisation du lien biologique apparaît en France à travers la loi de 1972 et la vérification légale de la paternité par l'examen des sangs. On peut ainsi passer de la vérité sociologique (la paternité « vraisemblable ») à la vérité biologique. Comme le souligne Francis Zimmermann, « en autorisant la contestation d'une filiation légitime sur la base des preuves biologiques », cette loi a introduit une « faille » dans le système juridique français (le Code civil connaît en effet trois types de filiation : légitime, naturelle et adoptive). La coïncidence des « décisions du juge avec la vérité biologique » est un nouveau fait de société qui, depuis plus de vingt ans, fait « sauter en éclats les fictions du droit réel » (1993, 223). Cette coïncidence est par ailleurs ambiguë si l'on pense à la clause de l'anonymat du donneur de sperme. (…) (Christian Ghassarian : « Introduction à l’analyse de la parenté » - Point Seuil)
PARTIE III : MYTHES ET LITTERATURES ORALES
DOCUMENT N° 13 : littératures orales
On doit à Van Gennep les distinctions les plus claires entre ces trois types de récits collectifs. Chacun d'eux est défini selon cinq critères, dont les deux premiers concernent l'usage du récit – dans quel but le raconte-t-on et est-il objet de croyance ? – et les trois autres le contenu : quelle est la nature des personnages, quels sont le lieu et le temps de l'action ? Le mythe fait partie intégrante d'un système idéologique et s'accompagne fréquemment de rites. Il est objet de croyance parce qu'il fonde une conception de l'univers, de l'homme et de la société. Personnages, lieu et temps de l'action se tiennent tous à distance du monde des hommes Les personnages sont des divinités ou des archétypes (ancêtres mythiques). Le lieu de l'action est hors de l'atteinte humaine (Paradis terrestre, Olympe, etc.). De même, le temps de l'action est situé avant l'histoire humaine – In illo tempore..., «En ce temps-là...», pour reprendre la formule de Mircea Eliade – ou à la fin des temps. Le conte a pour visée essentielle le divertissement, d'où la variété des contes : contes merveilleux (contes de fées), contes d'aventures réalistes, contes d'épouvante, contes facétieux, contes de mensonge, contes licencieux, etc. Le conte n'est pas objet de croyance : il est perçu comme une fiction, même si le conteur affirme –par jeu, principalement dans les récits de mensonge –l'authenticité de l'histoire. Les personnages de contes ne sont pas individualisés, ils représentent des types (le roi, la sorcière, le prince charmant, la bonne fée, l'ogre, etc.) et même les noms propres relèvent de caractéristiques physiques (Barbe-Bleue, le Petit Poucet, le Chaperon Rouge, etc.). L'action n'est ni localisée ni temporalisée, c'est le fameux « Il était une fois, dans un pays lointain... ». La fable est un cas particulier du conte : c'est un conte bref, à tendance moralisante, dans lequel les personnages sont le plus souvent des animaux ou des objets anthropomorphisés. La parabole, quant à elle, peut être définie comme un récit exemplaire fictif, qui s'intègre dans un enseignement moral ou religieux. La légende urbaine se rapproche beaucoup de la fable et de la parabole par sa brièveté narrative et sa visée morale. De même, elle ressemble au conte en général par ses protagonistes souvent anonymes et stéréotypés : l'ouvrier a succédé au paysan, le savant au sorcier, le séducteur au prince charmant, le maniaque urbain à l'ogre, etc. Mais la légende urbaine se distingue du conte, de la fable ou de la parabole par le fait qu'elle est objet de croyance. La légende se présente en effet comme un récit authentique, historique, relatant des faits réels exceptionnels, qu'ils soient admirables (légendes dorées, hagiographies, récits héroïques) ou détestables (légendes noires). Elle est donc d'abord objet de croyance. Les personnages sont individualisés. L'action est localisée et datée. Les légendes urbaines se caractérisent par des personnages plus souvent inconnus que célèbres et par un enracinement dans le temps présent. Van Gennep montre que l'on peut étudier les formations et les transformations légendaires par des processus de personnification/dépersonnification, localisation/délocalisation, temporalisation/détemporalisation. Pour Van Gennep, un même récit peut passer d'un genre à l'autre par modification de tel ou tel critère. Ainsi un mythe qui s'historise devient une légende (la Genèse biblique). A l'inverse, une légende transposée dans le monde des dieux devient un mythe (évhémérisme). Une légende ou un mythe auquel on ne croit plus prend le statut de conte (contes religieux, contes étiologiques, qui expliquent l'origine de tel animal ou de telle plante), tandis qu'un conte qui personnifie, localise et temporalise accède au rang de légende (la légende de la famille des Lusignan, qui prétend descendre de la fée Mélusine). (Jean Bruno Renard : RUMEURS ET LEGENDES URBAINES – Que sais je ? – P.U.F. – Paris – 1999)
Document 14 : La Structure des Mythes1 by Claude Lévi-Strauss (Annotated by Elizabeth Benware )
(…) la mythologie sera tenue pour un reflet de la structure sociale et des rapports sociaux. Et si l'observation contredit l'hypothèse, on insinuera aussitôt que l'objet propre des mythes est d'offrir une dérivation à des sentiments réels, mais refoulés. (…)Reconnaissons plutôt que l'étude des mythes nous amène à des constatations contradictoires. Tout peut arriver dans un mythe ; il semble que la succession des événements n'y soit subordonnée à aucune règle de logique ou de continuité. (…). D'où le problème : si le contenu du mythe est entièrement contingent, comment comprendre que, d'un bout à l'autre de la Terre, les mythes se ressemblent tellement? (…). Les anciens philosophes raisonnaient sur le langage comme nous faisons toujours sur la mythologie(…). aussi la contradiction ne fut-elle résolue que le jour où on s'aperçut que la fonction significative de la langue n'est pas directement liée aux sons eux-mêmes, mais à la manière dont les sons se trouvent combinés entre eux. (…) On vient de distinguer la langue et la parole au moyen des systèmes temporels auxquels elles se réfèrent l'une et l'autre. Or, le mythe se définit aussi par un système temporel, qui combine les propriétés des deux autres. Un mythe se rapporte toujours à des événements passés : « avant la création du monde, » ou « pendant les premiers âges, » en tout cas, « il y a longtemps. » Mais la valeur intrinsèque attribuée au mythe provient de ce queces événements, censés se dérouler à un moment du temps, forment aussi une structure permanente. Celle-ci se rapporte simultanément au passé, au présent et au futur. (http://litgloss.buffalo.edu/levistrauss/text.shtml)
Document 15 : Le mythe de Maui
Maui est un des personnages les plus connus dans le monde polynésien(…) Ses aventures sont contées dans toutes les îles avec quelques variantes. Selon les versions, Maui est le grand prêtre des Dieux dont le but est d’étendre sa prêtrise : « Mâ-û-i (Invocation) était le nom des prières au marae ainsi appelées en souvenir de Mâ-û-i le prêtre, fondateur des rites religieux. »[2] Il est aussi prophète. Dans d’autres versions, il est demi-dieux, fils du soleil contre qui il est en colère, ou bien fils de Ta’aroa et d’une humaine. Cependant, quelques soient les versions, Maui est toujours considéré comme un héros. En effet, du fait de sa naissance, il a un statut particulier. « Né prématurément, fœtus informe abandonnée sans rituel pour mort aux flots des vagues […] il sera sauvé in extremis par son ancêtre Tama-nui-ki-te-Rangi. »[3]
Le mythe et son analyse Nous nous attardons ici sur le mythe de Maui attrapant le Soleil. Nous nous basons sur l’ouvrage Légendes tahitiennes présentées par Louise Peltzer, qui a l’avantage d’exposer la version du mythe en tahitien et en français. Le mythe retrace la capture du Soleil par Maui. Ce dernier en colère contre le Soleil, qui n’illuminait les journées que de quelques heures, forçant ainsi les humains à manger cru ce qui les rendirent malades, décida de lui tendre un piège afin de permettre aux hommes de bénéficier d’assez de lumière pour leurs travaux. Capturé, le Soleil fut contraint d’obéir et de ralentir sa course dans le ciel. Ce mythe met en scène quatre personnages : Ta’aroa, le soleil, Maui et Hina. Ta’aroa est le dieu de la création. Il est l’Unique : « Ta’aroa-le-grand, l’Unique, avait installé la voûte céleste, il avait stabilisé le socle terrestre »[4]. Le soleil est un élément naturel. Maui est le protagoniste du mythe. Dans cette version, on ne connait pas sa généalogie. Hina est la petite sœur de Maui. On constate donc qu’il y a plusieurs sphères en commun. En effet, on trouve trois sphères : la sphère des dieux, représentée par le dieu créateur Ta’aroa, la sphère de la nature symbolisée par le soleil et la sphère humaine incarnée par Hina. Nous avons « oublié » Maui, car du fait de son action, il nous semble qu’il ne fait partie d’aucune des sphères que nous venons de citer. Ta’aroa, en tant que dieu, est supposé être un être infaillible : « Ta’aroa-le-grand, l’Unique, avait installé la voûte céleste, il avait stabilisé le socle terrestre. […]Ta’aroa avait tout prévu pour rendre la vie des hommes agréable dans ce monde. Seulement, il avait oublié une chose, il avait oublié de régler la marche du soleil. »[5] Or, on constate qu’il omet de régler la marche du soleil. Comment est-ce possible ? Comment un dieu, être parfait par principe, peut-il commettre une erreur de cette taille ? Son « oubli » cause la perte des hommes, alors que son objectif est créer un monde où les hommes vivraient de manière« agréable ». Les hommes sont présentés comme des êtres contraints : « en effet, les habitants de cette terre ne pouvaient vaquer tranquillement à leurs occupations, ils n’avaient pas le temps de finir leurs ouvrages que déjà le soleil terminait sa course dans le ciel. Les hommes n’avaient pas le temps de cuire leurs aliments, ils avaient la peine le temps d’allumer leur four et d’y mettre leur nourriture que déjà il faisait nuit. »[6] Ils sont dépendants du soleil. Ils sont tant dépendants qu’ils ne peuvent pas se nourrir de manière convenable :« à force de manger cru, leurs lèvres s’enflammèrent »[7]. Qui plus est, ils sont présentés comme des êtres non novateurs :« les hommes n’avaient plus le temps de terminer leurs travaux »[8][8]. Qu’est-ce qu’ils les empêchent de créer une autre source de lumières leur permettant d’arriver à leur fin ? On remarque donc que le soleil est un élément non contrôlable, ni par les dieux, ni par les hommes, d’où le statut particulier de Maui, qui lui y arrive. Maui est guidé par la colère. La souffrance qu’éprouve sa sœur le conduit à agir. Il est intéressant de voir qu’il s’en prend au soleil. Il n’en veut pas à Ta’aroa qui est responsable de cette erreur. Il décide de régler le« problème » de la marche du soleil lui-même, sans faire appel aux dieux. Il fait donc preuve d’innovation contrairement aux hommes. Il fait d’autant plus preuve d’innovation qu’il décide de rajouter une mèche de cheveux d’Hina dans son piège, comme si les cheveux de la jeune fille disposaient d’un quelconque pouvoir. Lorsqu’il met en place son piège et qu’il arrive à capturer le soleil, il n’hésite pas à mettre en jeu le sort de l’humanité : « dès qu’il aperçut le disque solaire, Maui lança son piège. […] Le soleil était devenu comme fou à ce moment-là. Il entra dans une violente colère et décida de chauffer. Il chauffa, il chauffa si fort que toutes les lianes brûlèrent, toutes les écorces brûlèrent, seul le cheveu de Hina résista à la chaleur. Le récif brûla aussi, les poissons moururent calcinés, la mer bouillonnait, malgré cela, Maui ne lâcha pas prise. »[9] De par cette action, Maui possède un statut différent des autres protagonistes. En effet, il est le seul à oser combattre un élément naturel. Par conséquent, on peut affirmer qu’il est plus qu’un homme. Qui plus est, il arrive à contrôler cet élément. Il est d’une certaine manière supérieur aux dieux. Il leur est supérieur grâce à son intelligence et à sa malignité. On peut donc le considérer comme un héros. En effet, grâce à son intelligence il réussit à vaincre le soleil. Il possède donc un statut particulier, qui ne le classe ni chez les hommes, ni chez les dieux. Sa victoire marque le contrôle du temps. En effet, la capture du soleil n’illustre pas seulement le contrôle de la lumière. Il s’agit du contrôle du temps : en ralentissant la course du soleil, Maui permet aux hommes de bénéficier de plus de temps pour cuire leurs aliments et surtout pour finir leurs ouvrages. Il est donc l’intermédiaire entre les hommes et les dieux. Arrêtons-nous quelques instants sur le personnage de Hina. Il est intéressant de voir que Hina est le seul personnage féminin du mythe. De plus, elle est la seule victime du soleil nommée, comme si à elle seule elle représentait la condition humaine victime de la nature. Qui plus est, c’est grâce à sa mèche de cheveux que Maui arrive à emprisonner le soleil. Puisque c’est par elle que la résolution du problème initial est possible, peut-on émettre l’hypothèse que sa condition de femme lui permet d’acquérir un certain pouvoir ? Etant donné que nos propos se concentrent sur le personnage de Maui, nous laissons cette hypothèse en suspend, mais il serait intéressant d’explorer cette voie en ce qui concerne le statut des femmes dans la mythologie polynésienne.
Puisque Maui est le justicier, peut-on considérer ce mythe comme l’illustration de la remise en question du pouvoir ? Etant donné que nous disposons de peu d’informations sur l’histoire de la politique en Polynésie, nous n’avancerons pas réponses à cette hypothèse. Cependant, nous gardons l’idée selon laquelle Maui est un personnage intermédiaire entre les dieux et les hommes et qu’ils possèdent un certain pouvoir. Une question surgit : peut-on, comme beaucoup d’analyses le font, considérer Maui comme un trickster ?
Une autre analyse Comme nous l’avons précédemment, Maui, du fait de sa naissance, possède un statut particulier : « né prématurément, fœtus informe abandonné sans rituel de mort aux flots des vagues, il réunit toutes les conditions pour incarner une entité redoutable, résultat d’une « mauvaise mort » : prématuré et privé de rites de passage, il était voué à hanter les vivants de la pire façon ; esprit sans identité, non désacralisé à la naissance, sans rites d’ancestralisation, il avait tout pour devenir v?rua’ino, tupapa’u, esprit errant et malfaisant… Heureusement, il sera sauvé in extremis par son ancêtre Tama-nui-ki-te-Rangi »[10] . Par sa naissance, Maui transgresse déjà le monde. (…) Qui plus, Maui est un être transgressif par son action : il est le seul à oser combattre un élément naturel, (…) Laura Makarius, dans son article Le mythe du« trickster », met en avant l’hypothèse que Maui est un trickster. Dans une note de bas de page, elle définit le trickster comme un « «joueur de tours », mais avec une nuance de malice que l'expression française ne rend pas. […] Il représente une combinaison de force, de faiblesse, de sagesse, de puérilité et de malice (Grinnell, 257 ; v. aussi Brinton, 1868, 161-2). »[12] Sa thèse est que le trickster « c'est la violation magique des interdits »[13] . (…) Maui est un trickster parce qu’il transgresse un ordre. (…)Par conséquent, nous définissons le trickster comme un être transgressif par sa nature et par ses actions. (Source : http://mauiethnographie.canalblog.com/archives/2011/05/04/21057659.html
Document 16 : mythe inuit
Ces recherches me firent bientôt découvrir la position centrale occupée par la procréation humaine dans la conception du monde inuit. Le foetus y est, en effet, le lieu par excellence où s’articulent les diverses composantes de l’univers : la composante masculine, exprimée par le sperme de l’homme qui bouche le conduit utérin et amorce ainsi le procès de reproduction ; il se mélange ensuite au sang maternel pour donner à l’embryon sa forme et sa structure, puis sa cohésion. La composante féminine, exprimée par le sang de la mère qui, en coagulant, participe à l’oeuf embryonnaire, puis forme le sang du foetus. La composante animale, représentée par la chair animale, qu'absorbe la femme enceinte, et que consomme ensuite le foetus dont elle va constituer la chair. La composante surnaturelle, enfin, représentée par les âmes noms des ancêtres décédés, qui se réincarnent dans l’enfant à naître et attendent d’être reconnus par les vivants. Ainsi, dans le petit iglou utérin, microcosme de l’univers, se rejoue l’apparition de la vie humaine(…) L’humanité première vécut à ses débuts sur terre dans une obscurité quasi utérine, avant d’avoir accès à la lumière du jour, comme l’humanité ultérieure, aux prises avec la complexité croissante des règles de la vie et la multiplicité des esprits, vécut dans un obscurantisme dangereux, avant d’avoir accès aux lumières du chamanisme. Le principe actif de tout pouvoir chamanique est la clairvoyance qui se dit en inuit : Qaumaniq, « la lumière ». Une étude approfondie des mythes d’origine révéla aussi que la différenciation des sexes constituait la première grande différenciation de la cosmogénèse inuit. Cette différenciation est, d’ailleurs, également conçue comme un moment essentiel dans la reproduction de la vie humaine. De nombreux récits illustrent ces croyances : les Inuit pensent qu’un foetus peut changer de sexe en naissant. (...)Les souvenirs intra-utérins d’Iqallijuq, une femme inuit d’Igloolik qui raconte avoir changé de sexe à la naissance, apportent un intéressant éclairage sur les sipiniit. Ses souvenirs remontent avant sa conception, quand, sous la forme de l’âme invisible du grand-père maternel dont elle porte le nom, Savviuqtalik - récemment décédé quand commence le récit -, elle sortit de la tombe et s’approcha de sa fille (en fait, la mère d’Iqallijuq), qui était accroupie, non loin de là, pour faire ses besoins naturels. Elle toucha sa ceinture dénouée et se retrouva dans son utérus, qui ressemblait à l’intérieur d’un petit iglou (cf. fig.). Là elle absorba une nourriture de couleur blanchâtre, qu'un chien venait régulièrement régurgiter, et passa de l’état d’âme à celui de foetus mâle. Le foetus grossit rapidement et, quand l’iglou devint trop petit, décida d’en sortir. Il saisit donc les outils masculins, mais, se souvenant des difficultés de sa vie antérieure de chasseur, du froid et des dangers, il se ravisa et décida de revivre dans un corps de femme. Reposant alors les outils masculins, il prit les outils féminins, et sortit dans un violent effort. Son pénis se rétracta aussitôt, son périnée se fendit et il naquit fille... Ce type de réminiscence n’est pas rare chez les Inuit ; il se rencontre dans les divers groupes et sa crédibilité s'appuie sur un mythe très connu : l’histoire de la femme, battue par son mari, qui se transforme en chien, puis en diverses espèces de gibier, avant de redevenir foetus dans l’utérus de la femme de son propre frère, et de renaître garçon. Un autre mythe, en rapport avec le « transsexualisme » périnatal, décrit la cosmogénèse inuit et illustre le premier changement de sexe ; il raconte comment les deux premiers humains sortirent de deux petites buttes de terre, sous forme de deux mâles adultes. Ils voulurent bientôt se multiplier et l’un d’eux mit l’autre enceint. Quand la grossesse vint à son terme, ils constatèrent l’incapacité d’accoucher de l’homme enceint. Son compagnon provoqua par un chant magique la résorption de son pénis et une ouverture dans son périnée, le transformant en femme, la première femme. Celle-ci accoucha bientôt d’un fils. D’eux sont issus, dit-on, tous les Inuit. Ainsi, au niveau infra humain de la vie, celui du passage de la vie utérine à la vie humaine, le sexe est-il instable et sa frontière peut-elle être aisément franchie, dans les deux sens, de garçon à fille et de fille à garçon. Cette instabilité existait à l'origine de la vie humaine, elle est présente encore lors de chaque accouchement. (Bernard Saladin D’Anglure : “Le « troisième sexe ».” - La Recherche, no 245, juillet-août 1992)
Document 17 : la proximité de l’inuit et de l’animal
Un fœtus perdit conscience dans le ventre de sa mère et un avortement s’en suivit. La mère voulut garder l’événement secret. Le fœtus tombé sur le sol fut avalé par les chiens. C’est ainsi qu’il vécut parmi les chiens après s’être transformé en chien. Sa vie fut difficile car, timide, il n’osait se battre pour obtenir la nourriture. Puis il alla de métamorphose en métamorphose en prenant la forme de différents animaux. Il vécut parmi les phoques annelés et apprit que tous les chasseurs ne savent pas honorer les phoques capturés en leur offrant de l’eau douce pour étancher leur soif. Pourtant les phoques aiment s’offrir aux humains et disent même qu’ils cherchent à venir à la maison. Il vécut un certain temps parmi les loups mais trouva leur vie épuisante, car les loups marchent sans s’arrêter et toujours à la recherche de nourriture. Il arriva chez les caribous. Ce fut une halte relativement heureuse. Les caribous mangent souvent et aiment prendre la vie du bon côté mais, comme les loups ; ils marchent beaucoup et sont terriblement craintifs. Il arriva alors chez les morses. Là aussi la vie était agréable. No seulement les morses avaient beaucoup de nourriture mais ils n’avaient peur de personne. De plus, en guise de divertissement, ils passaient leur temps à s’embrasser. Il alla ainsi d’animal en animal jusqu’au jour où il prit à nouveau la forme d’un phoque. Il se mit alors à penser qu’il voulait se transformer en être humain. Capturé par un chasseur, il profita de ce que son épouse dormait pour se glisser dans son utérus et devenir fœtus. D’abord personne ne remarqua sa présence mais on découvrit, un peu plus tard, que la femme était enceinte. Le fœtus se trouvait bien là où il était et décida d’y rester. Il montrait de temps en temps le bout de son nez comme pour regarder dehors mais sans plus. Vint le temps où il voulut vraiment sortir, car il ne lui restait presque rien à manger et surtout les murs de sa maison étaient en très mauvais état. Il se sentait si à l’étroit qu’il voulut sortir. Il fit un effort et apparut sous la forme d’un être humain. Vous pouvez deviner qu’à ce moment précis tout le monde s’agita autour de lui car il avait voulu sortir et y était parvenu. Après sa naissance, son père et sa mère respectèrent tous les rituels qu’ils devaient respecter. C’est ainsi qu’il put grandir et devenir un jeune homme du nom de Aumarjuaq, la grande braise. (Michelle Therrien : « Printemps Inuit – Naissance du Nunavut » – Indigène Editions - 1999 – page 38-39)
Document 18 : Les Inuits voient dans leur environnement des rappels de parties anatomiques suggérées par une multitude de formes ou d’apparence. Il existe des cous et des colons (certaines algues), des têtes (collines arrondies), des colonnes vertébrales (tiges de plantes, crêtes de montagnes), des langues (feuilles), des index (pointes de terre), des flancs (bords de lacs), des espaces inter-sourciliers (élévation entre deux plans d’eau), des personnes chauves (îles sans verdure), des glaces lacustres évoquant l’embryon (…) Les règles féminines (aunarutit) sont voisines de la fonte de la glace et de la neige (aunnaq). Le sang menstruel s’oppose au fœtus comme l’eau à la glace solide. » (Michelle Therrien : « Printemps Inuit – Naissance du Nunavut » – Indigène Editions - 1999 – page 50)
Document 19 : « Le phoque était au centre des rapports que les Inuits côtiers entretenaient avec le sacré (…) Selon Iqallijuq Uqumaaluk, il faut après al capture d’un phoque lui donner à boire, imiqtisijuq ; ce geste permet au phoque de se régénérer et de revenir à nouveau. Immaruituq, pour sa part nous a dit qu’il ne fallait jamais qu’un animal souffre sinon il se vengera sur la personne elle-même ou celui ou celle qu’elle aime. Imaginez ce qu’on peu ressortir les chasseurs inuit lorsqu’ils ont entendu dire qu’à Terre-Neuve, les phoques étaient dépecés vivants ! » (Michelle Therrien : « Printemps Inuit – Naissance du Nunavut » – Indigène Editions - 1999 – page 108)
Document 20 : Réseaux de vivants, solidarités de morts
Une informatrice islandaise déclarait un jour : « Mais pourquoi des étrangers font-ils tout ce chemin pour venir poser des questions aussi bêtes ? C’est comme si moi j’allais en France pour interroger les gens sur… sur ce plateau de fruits par exemple ! [Sur la table, face à nous, était posé un plateau avec quelques fruits.] Que peut-on bien en dire ? C’est un plateau rond, de couleur blanche avec deux pommes et trois bananes à l’intérieur ! Et après ? Il y en a dans toutes les maisons, des plateaux comme ça, et pas seulement en Islande ! Est-ce que ça vaut la peine de faire des milliers de kilomètres pour ça ? Non ! Eh bien quand tu viens nous poser des questions sur les morts et je ne sais quoi d’autre, ça revient à la même chose ! Il y a des morts dans toutes les maisons comme il y a des plateaux avec des fruits… Qu’est-ce qu’on peut bien te dire de plus ? D’ailleurs, tu sais, les gens sont très étonnés ici de voir quelqu’un qui pose ce genre de questions, et ils se disent que t’es vraiment bizarre. » Si, pour l’ensemble européen, l’analyse des relations morts-vivants constitue désormais un dossier conséquent, il est encore des sociétés qui en demeurent absentes. C’est le cas des groupes insulaires de l’Atlantique Nord et notamment de l’Islande, pour laquelle fort peu d’études rendent compte de sa place dans ce panorama des sociétés chrétiennes de l’Occident. Le fait est d’autant plus remarquable que, comme en témoigne cet extrait d’entretien, la familiarité avec les morts s’y présente comme une simple invitation d’étude pour l’ethnologue des religions. En effet, dans cette société « à lignages », luthérienne protestante à plus de 95 %, les morts partagent non seulement leur espace domestique avec les vivants mais aussi, comme nous allons le voir, n’ont de cesse de les rencontrer et d’échanger des « services ».avec eux. L’observation ethnographique de ces liens permet alors de mettre en lumière comment des réseaux de solidarités sont tissés entre les groupes de morts et de vivants, impliqués dans une relation de « partenariat symbolique » . Si l’on entend cette expression dans une acception restreinte, référant à une organisation des expériences sensibles au sein d’un système sémantique, on peut dès lors appréhender ce « partenariat symbolique ».comme un système d’échanges dont il convient d’identifier la structuration générale. En outre, et c’est là un fait majeur, cette relation s’enrichit également d’une pérennité historique. D’abord, des documents relatant des faits précis, antérieurs au christianisme, décrivent un partenariat très analogue à celui que l’enquête ethnologique révèle. Ensuite, beaucoup plus tard, à la fin du xixe siècle, les premiers folkloristes islandais ont à nouveau souligné, dans les recueils d’histoires populaires, cette présence des morts en Islande et, de manière plus large, un peu partout en Europe du Nord (Árnason 1954-1961). Entre les documents de ces deux périodes historiques, le matériau islandais est assez maigre, mais quelques archives, égarées çà et là, permettent cependant de déceler cette même présence (Sveinsson 1940). Il est donc à peu près certain que cette relation contemporaine des Islandais avec leurs morts n’est pas une affaire récente mais s’inscrit dans la longue durée.
Présences ordinaires, expériences partagées Pour les Islandais, la présence des morts enveloppe celle des vivants dans une domesticité quotidienne : « Il y a des morts dans toutes les maisons comme il y a des plateaux avec des fruits ! ».Tel est le ton de l’enquête qui fut menée dans la région d’ÍsafjörUur, petite ville de 3 500 habitants du nord-ouest de l’Islande, ainsi que dans les villages de pêche avoisinants (comptant entre 100 et 1 000 habitants). L’opinion générale était partout la même ; les ancêtres ne peuplent pas un espace séparé, rien ne les éloigne vraiment et les informateurs étaient toujours surpris lorsque je demandais où ils se dirigent après leur trépas. A cela, la même informatrice répondit : « Et où veux-tu qu’ils aillent ? Sur la Lune ? ».Sa réponse, toujours aussi sarcastique, stipulait bien l’inadéquation flagrante de ma question par rapport à la manière dont elle pensait les morts ; situer leur lieu d’appartenance topographique ou symbolique était bien plus caractéristique d’un souci ethnographique que d’une réelle préoccupation indigène. Elle ajouta ensuite : « Ils peuvent bien aller où ils veulent, ça ne change rien puisque de toute façon ils sont là. ».Morts et vivants peuplent ainsi un même « monde », lieu des existences ordinaires, et leurs rencontres s’apparentent souvent à des « entrevues ».survenant de manière impromptue. On se croise, ici ou là, et rien ne semble déterminer a priori la raison du contact : « C’est le hasard des rencontres », affirme-t-on. (…). En conséquence, si les Islandais ont l’habitude de rencontrer les morts, c’est aussi et surtout parce qu’ils savent narrer leurs expériences. Or, toute narration appelant une autre narration, ce sont aussi les rencontres avec les morts qui sont à chaque fois reprovoquées dans ce processus. Les réseaux tissés sont ainsi de plus en plus vastes, échappant généralement aux vivants qui ne mesurent pas l’ampleur de leurs ramifications. Une anecdote illustrera ce propos. Au cours de mes enquêtes, comme tout ethnologue sur son terrain, j’étais fréquemment en quête de nouveaux informateurs ; je cherchais à rencontrer des gens qui accepteraient de me parler de leurs rêves et visions. A la fin de chaque entretien, j’avais pris pour habitude de demander à mon interlocuteur s’il pouvait m’indiquer quelqu’un d’intéressant à qui parler. Souvent je n’obtenais aucune indication réelle, tellement ils étaient persuadés de l’extrême banalité de ce qu’ils avaient à dire. Un jour, il me vint l’idée d’inverser ma requête : au lieu de demander à rencontrer des vivants qui pouvaient me parler de morts, je demandai à rencontrer les vivants auxquels tel ou tel mort s’était adressé ! Mon carnet d’adresses se remplit aussitôt. Untel savait que tel autre avait été contacté par ce mort, et chaque nouvel informateur m’indiquait à son tour d’autres personnes. De nouvelles ramifications se produisaient avec d’autres morts, tissant une véritable toile de contacts enchevêtrés. Je suivis alors la piste de tout un réseau social dont le fil conducteur avait été, au départ, l’interpellation par un même mort ! J’arrivai ainsi très vite à des réseaux extrêmement complexes où chacun parlait avec chacun, mais sans jamais qu’un seul ne soit au fait de la globalité du réseau tissé.
Un commerce symbolique Au sens le plus large, nous comprenons donc que les rencontres avec les morts sont en quelque sorte des « formes de discours ».qui renvoient à des expériences culturellement codées, que leur dessein premier est toujours d’être communiquées à d’autres vivants et que c’est par ce biais que les échanges avec les morts ont lieu. Ces formes de discours conduisent ainsi, parmi les vivants, à l’élaboration de réseaux extrêmement complexes, mais dont les morts sont les « initiateurs » . Le cas en est particulièrement frappant pour les songes qui jouent le rôle de « faire-part », conduisant les vivants à se rencontrer sur la demande des morts : « Une fois j’ai rêvé d’une femme que je ne connaissais pas. Elle était âgée et elle avait un visage doux et lumineux. C’était une bonne impression et je me suis sentie bien. Mais elle m’a dit, un peu en colère : “Je ne suis pas contente de ce que Erla, ma fille, est en train de faire en ce moment !” Et elle me demanda de téléphoner à sa fille pour le lui dire ! Alors j’ai compris que ce devait être la maman d’une amie qui habite dans le Nord-Est ; sa mère venait juste de mourir. Le lendemain j’appelle mon amie et je lui demande : “Mon Erla, qu’est-ce que tu es en train de faire en ce moment ? J’ai vu ta maman qui m’a dit de te dire qu’elle n’était pas du tout contente à cause de ce que tu fais !” Alors Erla m’a dit que c’était à cause de la commode. Une vieille commode de famille qu’elle venait de vendre ! Et sa maman ne voulait pas. Erla l’avait déjà vendue et elle avait pris l’argent, mais elle est allée voir l’acquéreur pour lui dire qu’elle devait la reprendre.
– Et elle a récupéré sa commode ?
– Oui, et sa maman est venue la voir ensuite pour la remercier. »
Ce témoignage illustre à nouveau comment s’opèrent les échanges entre morts et vivants. (…) L’apparente futilité de ces messages (pour lesquels les Islandais disent parfois « qu’ils ne servent à rien » ) ne doit pourtant pas cacher une motivation essentielle si l’on considère l’ensemble de l’échange généralisé ; en effet, ils sont autant d’apports nouveaux qui nourrissent et entretiennent le réseau des échanges. De ce point de vue, ils créent une « habitude de rencontres ».qui facilite la prise en charge des messages plus importants qui interviennent lors des circonstances de naissance et de décès. Ces derniers sont, dans l’économie générale de ce système symbolique, les rouages fondateurs de l’échange. (…) En guise de conclusion, l’anecdote suivante illustrera comment ces enjeux symboliques peuvent être activés par un événement en apparence sans lien avec eux. Il y a peu de temps en effet, la presse internationale se scandalisait de l’opinion publique islandaise. Une industrie de recherche biomédicale obtenait le droit de ficher, dans une gigantesque base de données, la carte génétique de tous les Islandais. Compte tenu de l’homogénéité de la population, l’industrie annonçait que l’exploitation de ce fichier allait permettre d’importantes découvertes sur la transmission de certaines maladies. Seulement voilà, il ne s’agissait pas de n’importe quelles données mais de cartes génétiques comptabilisées par milliers… La réaction de la presse internationale fut alors unanime, « tirant la sonnette d’alarme pour dénoncer les risques de dérives ».dès lors qu’on a accès à la valeur sacrée de l’homme moderne : son ADN. Mais plus que l’autorisation accordée à l’industrie coupable, ce qui choquait et scandalisait, c’était surtout la passivité manifeste des Islandais. Ces derniers ne réagissaient pas ou peu, en tout cas pas suffisamment, comme tout « homme moderne ».devrait réagir lorsqu’on en veut à son identité génétique. Même si des groupes d’opposition se manifestaient dans les milieux scientifiques et politiques, l’opinion publique demeurait silencieuse, parfois même acquiesçait. Cette nonchalance du peuple islandais vis-à-vis de l’entreprise menaçante avait, pour les autres pays occidentaux, quelque chose d’incompréhensible et d’impardonnable… Cette histoire n’est pas ici à juger. Mais ce qui est pour nous intéressant, c’est que la presse occidentale et l’opinion publique islandaise n’ont pas du tout fait la même lecture des événements ; ce qui pour les uns était un principe universel d’éthique était pour les autres une affaire locale, concernant des morts et des vivants ! En fait, ce que la presse occidentale n’avait pas vu, c’est qu’une base de données génétique constitue en soi une forme d’unification des morts et des vivants dans un continuum généalogique. D’ailleurs, l’entreprise d’exploitation génétique, dirigée par un Islandais, avait de ce point de vue fort bien présenté son projet. Pour obtenir l’accord des autorités, elle avait mis l’accent d’une part sur les qualités lignagères des familles islandaises, les seules d’Europe capables de dresser des arbres généalogiques de plusieurs dizaines de générations. De la sorte, l’entreprise ne faisait que poursuivre une passion généalogique, mettant les nouvelles technologies au service de ce « sport ».national et ancestral : le décompte des ancêtres. D’autre part, un argument de poids avait été brandi lorsque l’entreprise annonça que sur la base des 270 000 Islandais vivants pouvaient être retrouvées les cartes génétiques de quelque 600 000 Islandais ! Il est amusant de noter que les journalistes n’ont pas relevé ce dernier point qui consistait, explicitement, à remettre la main sur 330 000 ancêtres. (Christophe Pons : « Réseaux de vivants, solidarités de morts - Un système symbolique en Islande » - Terrain n°38 mars 2002 Qu'est-ce qu'un événement ?)
Ajouter un commentaire